Cheminez, le média des langues et des cultures d’ailleurs et d’ici, rend hommage en ce mois de janvier 2024 à l’Occitan, avec un entretien-fleuve divisé en quatre parties de Josiane Ubaud, lexicographe et ethnobotaniste en domaine occitan. Après avoir évoqué l’absolue nécessité de l’unification des langues pour leur sauvegarde et la manière dont l’État français les locuteurs de langues régionales en les considérant comme des délinquants, Josiane Ubaud nous parle cette fois-ci sur l’importance des connaissances fondamentales sur les plantes.
Propos recueillis par : Lamia DIAB EL HARAKE, Nidal EL YACOUBI et Gaëtan DESROIS.
_______________________________________________________________________
CHEMINEZ : Juste une petite remarque : c’est vrai qu’on s’est dit qu’on avait l’habitude de voir les artistes défendre les langues régionales (I Muvrini pour le corse ou Alan Stivell pour le breton), et on a été surpris de voir qu’une scientifique passait par sa discipline pour sensibiliser à sa langue.
JOSIANE UBAUD : C’est vrai que je suis à contre-courant ; je ne suis pas mono-spécifique : je ne suis pas une pure linguiste, ni une pure botaniste. Je n’ai jamais apprécié l’approche très froide des scientifiques : la doctrine interdit d’entrer en empathie avec les enquêtés ; si l’on entre en amitié avec eux, les enquêtés seraient susceptibles d’aller dans le sens désiré par l’enquêteur. Je trouve ça glaçant et méprisant. Mais quelle est la fiabilité de ces personnes qui enquêtent avec froideur et sans connaître la langue ? Ils ne posent pas les bonnes questions et, ne connaissant pas les terminologies, retranscrivent les noms comme des porcs.
CHEMINEZ : Vous vous présentez comme ethnobotaniste, et vous faites bien la distinction avec la botanique pure. Vous définissez l’ethnobotanique comme « de la botanique vécue par les humains ».
JOSIANE : Absolument. C’est le rapport entre les hommes et leur environnement vert. Même si je connais bien mon latin – on ne fait pas d’ethnobotanique sans avoir des connaissances pointues en botanique -, je sais que ça peut rendre indigestes les balades botaniques. Mais comme je maîtrise la botanique, la langue et la culture occitanes, je suis en mesure de raconter toutes les histoires autour des plantes et l’étymologie des noms.

Un de mes objectifs, c’est que les personnes qui participent à mes balades oublient ce bon vieux complexe « du patois qui serait inférieur au français ». Par exemple, je leur explique que le mot agast, « érable » en occitan, vient du grec ancien « akastos ». Autrement dit, mon occitan est plus proche de la racine antique que le français. Et on vient me dire que le mot « érable » serait supérieur à « agast » ? De même, le céleri se dit « api » en occitan, qui vient du latin « apium » ; quant au sureau, on dit « sambuc » par chez moi, et cela vient du latin « sambucus ».
Ce système de hiérarchisation des langues, avec une supériorité du français sur les langues autochtones, n’a donc pas de sens. J’utilise ces exemples pour bousculer les gens, qui se rendent compte de la proximité entre l’occitan et le latin.
CHEMINEZ : Créer un dictionnaire de botanique en occitan, ce n’est pas un acte anodin. On a l’impression que c’est une mise en concurrence avec des langues considérées comme scientifiques. Est-ce qu’il s’agit, pour l’occitan, de reconquérir un domaine dont le latin, le français et l’anglais ont tenté de l’exclure ?
JOSIANE : Bien sûr, c’est valable pour toutes les langues autochtones. Il est important de repartir à la conquête de tous les domaines qui nous ont été confisqués. Les académiciens nous reprochent de ne pas avoir de dictionnaires dans les domaines scientifiques ; ce qui nous empêcherait de parler de mathématiques… Plus barrés qu’eux, il n’y a pas !
Je me suis donc attelée à la rédaction d’un dictionnaire scientifique bilingue (français-occitan) et bidialectal (languedocien-provençal) de mathématiques, de physique, de chimie, de technologie et d’informatique. Mon dictionnaire scientifique met à l’honneur nos savants occitans et occitanphones, qui sont noyés sous l’étiquette « savants français ». Je conçois mon dictionnaire comme une reconquête par la preuve.

Je sors une flore en mai prochain : j’y donne les noms occitans et les caractéristiques générales de 500 plantes que j’ai sélectionnées. Mon but est, comme vous dites, de concurrencer les flores produites par Delachaux et Niestlé, qui ne reconnaissent que le français et l’anglais.
Les catalans sont largement en avance sur les occitans ; ils ont leurs dictionnaires, leurs flores. Les occitans doivent également avoir les-leurs. D’autant plus que les premiers traités d’algèbre au monde en langue vernaculaire ont été en occitan, du côté de Nice. Et ils sont toujours cités sur des sites chinois ou japonais.
CHEMINEZ : On voulait revenir sur une anecdote que vous avez racontée dans le documentaire PAMacée : cette rencontre avec ce berger que vous supposez illettré, et qui avait un savoir presque encyclopédique des plantes, et qui vous parlait de cette achillée millefeuille.
JOSIANE : On m’avait donné cette personne comme référence en provençal. C’était un vieux berger qui avait du mal à marcher et qui s’est mis en quatre pour me montrer tout son savoir ; un savoir encyclopédique. Il y avait une plante qu’il voulait absolument me montrer : c’était l’achillée millefeuille. « Il faut que je vous la montre, elle m’a sauvé la vie. » Il regardait soigneusement ses pieds : « C’est que je ne voudrais pas lui marcher dessus. »
C’est exceptionnel ! C’est de l’animisme ; il y a surtout un rapport à la nature et à la végétation qui est à l’opposé de ce nous disent les bobos ; c’est de l’anti-bobos. Des rencontres exceptionnelles comme ça, j’en ai fait partout ! Je n’ai jamais essuyé le moindre refus.
« Le terroir : cette richesse exceptionnelle dans la langue, dans le regard porté, dans la connaissance encyclopédique. »
Une fois, en m’arrêtant au hasard, je vois une femme – ce qui est plutôt rare – qui taillait des oliviers – une oléicultrice –, je m’arrête et aborde la conversation. Elle m’explique : « Ces oliviers, c’est toute ma vie. Ce sont ceux de mon mari. » Elle avait hérité de cette oliveraie.
Elle me dit : « Je prends la continuation, mais mes enfants ne comprennent pas. Ils voudraient m’amener au cinéma. Et je leur réponds : moi, mon cinéma, c’est ça, mon bien-être c’est ça. » Elle me dit aussi : « Quand j’enlève une branche, je lui dis pourquoi je l’enlève. » Elle parle mentalement : « Tu vois, je t’enlève parce que tu gènes celle-ci et que tu es un peu malade. » L’olive, c’est sacré chez nous. Voilà, des rencontres comme ça, j’en ai fait partout !
Des bergers avec un savoir encyclopédique, qui vous nomment toutes les plantes et qui vous disent : « Celle-là mes chèvres l’aiment bien, celle-ci non ; elle, je l’emploie après la pluie : les chèvres sentent la pluie qui va venir et en mangent deux fois plus la veille et ne veulent pas rentrer. » C’est tout ça, le terroir : cette richesse exceptionnelle dans la langue, dans le regard porté, dans la connaissance encyclopédique. Et tout ce savoir est enfermé dans des bibliothèques qui brûlent. Alors autant je suis enchantée quand j’ai rencontré ces gens, et ensuite, un quart d’heure après, il me vient l’envie de pleurer.

Plus je vieillis, plus me vient l’envie de pleurer. Encore une personne dont on n’a pas relevé l’immense savoir, alors que l’on me saoule avec la dernière pensée de Johnny Hallyday, ou avec tous ces artistes de cinéma qui n’ont rien à me dire, qui sont creux comme des radis creux, alors que je rencontre des gens comme ça qui sont exceptionnels.
CHEMINEZ : Votre travail a-t-il influencé d’autres botanistes en France, et êtes-vous en relation avec d’autres chercheurs venus d’autres régions ou pays ?
JOSIANE : Je n’ai pas connaissance d’un travail similaire effectué par des chercheurs français. En revanche, j’ai été contactée par des ethnobotanistes catalans – ce n’est pas un hasard – qui m’ont trouvée sur internet, et j’ai été invitée à un colloque à Llívia, en Catalogne. J’ai été reçue comme une princesse, et j’y ai mesuré les abymes entre ce qui se passe en Catalogne et ce qui se passe en France.
En Catalogne, dans ce colloque, il y avait des paysans, des pharmaciens, des chasseurs, des personnes qui fabriquaient de l’huile de cade, des diplômés et des gens de terrains. C’était extraordinaire. En France, c’est inconcevable. Des gens de terrain seraient immédiatement mis dehors parce que ne sont pas des sachants de qualité. En France, on a ce mépris vertical, qui est la suite du jacobinisme. N’a droit à la parole que l’universitaire.

Est-ce que le film PAMacée, que l’on évoquait tout à l’heure, aurait été primé en France ? La question se pose. Il a été primé en Italie, qui est un pays qui assume son plurilinguisme, puisque l’occitan y est reconnu comme langue nationale, mais pas chez nous.
Je tiens à dire toutefois que je donne envie à des jeunes de se battre. J’ai des jeunes dans mes sorties, et dans mes conférences.
CHEMINEZ : En découvrant votre travail, on s’est dit que ce soit en Corse, en Bretagne, en Alsace ou au Pays Basque, d’autres scientifiques voudraient peut-être, s’ils sont attachés à leur langue et à leurs paysages, faire le même travail. C’est un travail de Titan que vous avez fait et qui est très intéressant en termes de données scientifiques.
JOSIANE : Je pense quand même qu’il en existe. Mais les linguistes en langues autochtones, ils vous prennent un mot pour savoir si c’est influencé par le français ou pas, et font un article de quatre pages. Mais quelle est la retombée sociale de la langue ? Zéro. Mais ils se sont fait plaisir. Je ne travaille pas du tout dans cette perspective-là. Moi je travaille pour transmettre, et pour que d’autres prennent ce que j’ai mis en exergue et l’intègrent en mémoire.
Un exemple : en occitan, les noms d’arbres peuvent être aussi bien masculin et féminin. J’ai mis des années à comprendre pourquoi. Beaucoup sont féminins par héritage du latin : chez les latins, tous les arbres étaient féminins. Ce qui n’est pas le cas en Français. J’en parle en sortie, pour montrer que l’occitan n’est pas un patois mais du latin.

Le figuier, en occitan c’est la figuièra ; le peuplier, c’est la pibola. Il y avait cette ambiguïté-là : pourquoi certains arbres ont à la fois un nom masculin et un nom féminin ? Mistral était très flou là-dessus, il n’expliquait pas bien. J’ai fini par comprendre : on utilise le masculin pour parler en général de l’arbre, donc en feuilles, en fleurs : « Je plante un pommier » ; et l’arbre devient féminin dès qu’il est chargé de fruits. Or : qui donne des petits et des fruits ? Les femmes. Ça c’est d’une profondeur exceptionnelle.
Ça marche pour tous les arbres à fruits. J’ai raconté ça en sortie en Cévennes, et il y a une dame qui m’a dit : « Ah mais oui, mon grand-père me disait des fois castanhier et des fois castanhière ». Châtaigner au masculin et au féminin. Elle m’a dit : « Maintenant je comprends. »
Donc c’est ça aussi mon travail : faire remonter à la surface des éléments sémantiques qui se sont perdus, et inciter les gens à les remettre en chemin. Même de manière normative. Vous voyez comment le local nourrit le normatif. J’incite les gens à le faire pour tous les arbres porteurs de fruits même si ce n’est pas dans les dictionnaires.
CHEMINEZ : C’est drôle, parce que l’utilisation du masculin et du féminin des arbres, c’est même une réalité qui est plus scientifique en occitan qu’en français, puisqu’un arbre a les deux sexes.
JOSIANE : Exactement, donc c’est là que mon occitan est plus riche que le français. En français, c’est « le pommier » et point final. Il y aurait quelque chose à analyser avec la langue française qui est obsédée par le masculin… Dans les langues romanes, ce n’est pas le mimosa, le bégonia, le pétunia. Ce sont tous des féminins, parce que le nom latin de la plante est féminin. Pourquoi le français est obnubilé par le masculin ? Aucune langue romane ne fait ça. C’est étrange.
« C’est là que mon occitan est plus riche que le français. »
CHEMINEZ : C’est vrai qu’en français, c’est même directement le fruit qui est féminin : la pomme, la fraise, la cerise, la poire, la banane, la châtaigne.
JOSIANE : Tout à fait. Sauf pour le kiwi, parce qu’il ne vient pas d’ici. Cette caractéristique-là déborde sur les plantes à fleurs. En français, on achète un bouquet de violettes, et on plante des violettes. Pas en occitan. On achète un bouquet de violettes, au féminin, mais on plante un violettier. Un plan de violettes. Un champ de violettes, c’est une violettière. Pareil pour le melon. En français, je ne peux pas passer par un seul mot, je dois utiliser tout un groupe nominal : un plan de melon. Alors qu’en occitan, j’ai déjà un mot tout fait. On est plus riches. Ce n’est pas du militantisme, c’est objectif.
CHEMINEZ : Dans un monde globalisé, quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontée ?
JOSIANE : Sur le plan culturel, c’est cette fascination pour l’anglais qui ostracise nos langues autochtones. C’est le dada de tous nos politiques. Claude Hagège, un linguiste qui a eu le toupet de dire que les parleurs de langues autochtones défendaient mieux le français que les francophones monolingues, parle même d’une « élite vassalisée à l’anglais ».

Claude Hagège et « l’élite vassalisée à l’anglais »
En revanche, cette globalisation stérilisante – la golden sans goût, les musiques sans rien, la nourriture molle et sucrée à la McDo – lasse les gens et les font revenir au terroir. C’est à double-tranchant. Ce paradoxe a atteint son paroxysme avec la Covid qui a rendu les campagnes à la mode. Ça m’a fait beaucoup rire de voir tous ces parisiens déménager en troupeaux alors qu’avant ils tapaient sur les culs-terreux.
Cette mondialisation est menée par les politiques, qui sont par définition incultes… Ça fait branché de baragouiner anglais. Cependant, on fait des procès aux gens qui affichent en occitan. Il faut quand même le savoir.
CHEMINEZ : Quels enseignements, liés à la botanique ou de l’occitan, il ne faut surtout pas perdre ?
JOSIANE : Nommer et reconnaître les plantes, c’est la première démarche pour renouer avec son environnement. Je suis catastrophée de voir que les gens sont incapables de nommer les trente arbres fondamentaux. Donc vous portez votre regard sur du rien. Un peuple, c’est un tout : avec sa culture, sa langue, son territoire, son regard.
Max Rouquette disait : « Quand les plantes ne sont plus nommées, quand les chemins de garrigues ne sont plus parcourus, c’est la mort du pays. » Il avait complètement raison. Cela va à l’encontre de ce que pensent les écologistes qui se félicitent quand l’homme s’en va. L’homme a participé à la diversité des paysages, il a créé des architectures en pierres sèches, qui sont propres à tout le pourtour méditerranéen et qui font la beauté et la spécificité de nos paysages.
Effectivement, quand il n’y aura plus personne pour nommer les plantes comme elles doivent être nommées, et non pas en latin botanique, ce sera la mort du pays. Un jour, j’ai commis l’imbécilité de dire à un berger que les paysages jaunes recouverts de genêts dans les Cévennes c’était beau ; je m’en suis bouffé les doigts immédiatement après ; pour ce monsieur qui a connu la vie agricole dans cette région, il n’y avait pas de genêt. Le genêt est la marque de l’abandon des activités agro-pastorales. Ça donnait des litières pour les troupeaux, ça donnait des toitures pour les bergeries, et ce qu’on faisait brûler sur place donnait de l’engrais pour les pâturages. Donc n’allez surtout pas dire à un cévenol qu’une montagne jaune de genêts c’est beau ; pour lui ça pue la mort. Même chose pour les étendues de fougères.

Le genêt, marque de l’abandon des activités agro-pastorales.
Ce qu’on appelle chez nous les faisses, les cultures en terrasse – parce qu’on est très en déclivités ici – maintenues par des clôtures de pierres sèches, apportaient une beauté dans les paysages absolument extraordinaire, avec les couleurs des cultures différentes, les oignons bleus, les pommiers. Avec l’abandon de ces activités, les murettes s’écroulent, la forêt originelle gagne absolument tout, et au lieu d’avoir une diversité de paysages, vous avez une uniformisation.
Les écolos sont ravis, parce qu’ils sont anti-scientifiques au possible : parce que comme il y a fermeture des milieux, nous perdons toute la flore de lumière, par conséquent, nous perdons de la biodiversité à cause des abandons des activités humaines. Je m’oppose complètement à ces discours culpabilisateurs des activités humaines, à part bien sûr les bétonisations outrancières.
CHEMINEZ : Toujours dans ce super film, il y a un point que nous avons trouvé intéressant. C’est ce petit rappel que vous faites sur l’origine de l’expression « remède de bonne femme ». Est-ce que vous pourriez nous le réexpliquer pour nos lecteurs ?
JOSIANE : En latin, « fame » signifie la « réputation ». Un « remède de bonne fame », c’était un remède de bonne réputation. Aujourd’hui, on emploie le mot « fame » uniquement de manière péjorative : « une rue mal famée ». Il y a eu dégénérescence d’une expression positive, pervertie en « remède de bonne femme », qui signifierait « remède qui ne sert à rien ».
Ça en dit long sur la place des femmes. Cela a amené aux procès en sorcellerie des femmes, qui étaient brûlées parce qu’elles avaient du savoir, et qu’elles concurrençaient les médecins d’un côté et les prêtres de l’autre, les uns guérissant avec les prières, les autres avec des remèdes qui pouvaient vous tuer.

Procès en sorcellerie dans le Pays-Basque
Celles qui avaient ce savoir ancestral des plantes, qui certes ne guérissaient pas tout, se sont vues exterminées à travers toute l’Europe, par des malades mentaux, des sanguinaires. Dans les Pyrénées, un avait à son actif 160 sorcières brûlées. Ils se faisaient appeler « démonologues ».
CHEMINEZ : Est-ce que vous avez remarqué une évolution dans cette répartition des savoirs ? Maintenant, est-ce que c’est plus équitable entre hommes et femmes ?
JOSIANE : Les savoirs médicaux résiduels sont toujours féminins. Parce que ça fait partie de la femme qui donne la vie, et dont le devoir est de l’entretenir. Donc j’ai rencontré beaucoup plus de femmes cueillir des simples avec des propriétés que je n’avais vues nulle part ailleurs – ce n’est pas mon domaine de spécialité, les plantes médicinales. Mais c’est toujours des femmes.
CHEMINEZ : Dans l’étude Indigenious knowledge networks in the face of global change étudiant le rapport entre les langues et les plantes, réalisée auprès de peuples autochtones d’Amérique du Sud et parue dans PNAS en 2019, des scientifiques ont observé qu’une plante peut être utilisée dans la chasse et la construction par un peuple, et cette même plante sera utilisée par un autre peuple voisin à des fins spirituelles ou pour la pêche. Cette observation leur a permis de mettre en évidence que pour connaître toutes les propriétés et usages d’une plante, il est nécessaire de s’intéresser à toutes les langues et cultures des peuples qui l’utilisent. Peut-on considérer que la rédaction d’un dictionnaire en une langue régionale est un rétrécissement du champ d’application des plantes, et qu’elle doit-être une étape intermédiaire vers la création d’un dictionnaire multilingue ?
JOSIANE : Je tiens à préciser que dans l’étude que vous mentionnez il est question de peuples voisins, qui habitaient au même endroit en Amérique du Sud. Personnellement, je m’insurge contre ces propriétés symboliques qu’on attribue en général à une plante ; c’est pour moi une erreur scientifique fondamentale. Transposer la symbolique du tilleul allemand à un livre français qui parle du tilleul est une erreur fondamentale. C’est ce que j’appelle l’ethnobotanique hors-sol : une plante est attachée à un territoire, à une langue, à une culture ; elle fait sens à tel endroit.
« En partant du local et en revenant en arrière, on fait prendre conscience aux gens. »
Par contre, il me semble beaucoup plus intéressant – mais il me faudrait sept vies pour y arriver – de comparer les noms des plantes dans tout le bassin méditerranéen. Ça, ça fait sens, parce que nous partageons la même végétation.
Vous avez avez parlé de perspective : bâtir un dictionnaire supérieur ne peut se faire qu’avec la mise en œuvre d’un dictionnaire au niveau inférieur – sans classification de valeur.
J’ai d’ailleurs écrit une conférence sur les noms des légumes. J’y développais l’idée que les plantes ont voyagé avec les hommes par la Route de la Soie, la route des épices, la route du coton, tout comme les langues. J’ai donc décortiqué plusieurs noms de fruits et légumes : la tomate, l’aubergine, l’abricot.
On peut faire du local en donnant toutes les appellations du mot abricot dans les différents parlers occitans, mais ce qui est intéressant c’est de monter au niveau supérieur : d’où vient le mot abricot ? Ainsi, en partant du local et en revenant en arrière, on fait prendre conscience aux gens.
CHEMINEZ : Dans cette étude dont on parlait, les multiples usages des plantes permettent leur préservation, et parmi ces usages, il y a tous ceux qui sont en lien avec les croyances et les rituels. Vous-même, dans le documentaire PAMacée, vous insistez sur le fait que toutes les sociétés sont basées sur des rituels et qu’une société qui n’a plus de rituel c’est une société qui s’effondre.
JOSIANE : Complètement. Je ne suis pas la seule à le dire. Levi-Strauss l’a dit avant.
CHEMINEZ : Vous avez donné l’exemple du bouquet sacré de lavande aspic, et ce rituel de la cueillette au Pic du Loup qui permettait ensuite de l’accrocher dans les maisons pour éloigner les mauvais sorts et les mauvais esprits. Est-ce que vous pensez que cette préservation des croyances, et de cette transmission à travers les générations, c’est quelque chose qui peut permettre de préserver ces plantes-là ?
JOSIANE : La pratique de certains rituels utilisant des plantes spécifiques est en train de reprendre parce que les gens sentent une perte de sens au niveau culturel. Il n’y a pas d’éradication des plantes utilisées à cet effet ; les rituels permettent de continuer à les nommer, à les reconnaître et à les respecter.


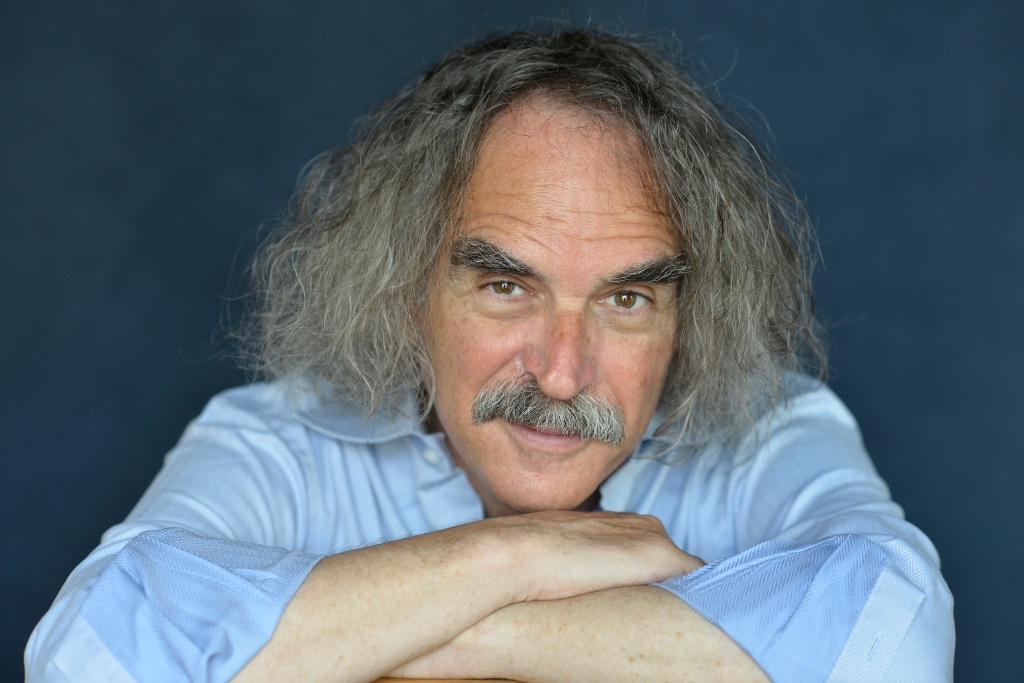



Laisser un commentaire