Il est des phénomènes culturels qui ne passent pas inaperçus. Leur ampleur, leur popularité, leur impact sur le public attirent l’attention et suscitent des interrogations, des débats. Nous allons ici aborder un de ces phénomènes majeurs, qui trouve des applications dans divers domaines de création culturelle : celui des séries. Notre propos sera notamment de relier ce sujet avec celui des possibles addictions engendrées par les séries. Nous allons essayer d’y réfléchir sans jamais prétendre édicter des vérités inébranlables. Réfléchir, donc, à ce que sont ces produits culturels sériels, largement consommés, qui nous environnent. Et il n’est bien sûr pas innocent d’exprimer la chose en termes de production et de consommation.
Les séries audiovisuelles nous donnent un très bon exemple de ces produits culturels qui semblent embarquer leurs consommateurs pour une croisière confortable, longue de plusieurs mois, plusieurs années, où – parenthèses jouissives dans le quotidien – on peut rencontrer, observer des habitudes hors de celles, rébarbatives, de la vie banale, et s’en délecter. De nouvelles habitudes, de nouveaux rituels, qui donnent à un esprit assailli par toute sorte de stress autant de repères apaisants ou stimulants, « heureux » en quelque sorte. Sociologues, journalistes, philosophes, psychologues… ont déjà beaucoup écrit, depuis plus de dix ou quinze ans, sur la « mode » de ces séries et sur l’engouement croissant qu’elles suscitent.

Nous allons nous efforcer de faire succinctement le point sur ce phénomène des séries, de leur succès, dans divers domaines de création culturelle et artistique, notamment, au-delà de l’audiovisuel, pour la littérature, qui est aussi concernée. Et nous allons nous interroger sur certaines de ses conséquences.
De quel phénomène parlons-nous précisément ? Ce phénomène, qui prend place dans le cadre de notre société de consommation, génère-t-il des addictions ? Quels sont les effets de ce phénomène sur la création culturelle et sur le public ? Telles sont les trois questions principales auxquelles nous apporterons des éléments de réponse.
Quand ou parle de séries de nos jours, on pense immédiatement au domaine télévisuel ou plus largement audiovisuel . Elles se multiplient et drainent un public à l’échelle planétaire, qui se compte en centaines de millions de spectateurs. Les sondages montrent une audience croissante pour ces productions culturelles qui désormais viennent du monde entier : Espagne, Danemark, Corée, Israël, France bien sûr, etc. Il n’en reste pas moins que les États-Unis restent dominants en la matière. Les formats sont très variables, quant à la durée des épisodes (même si la durée d’une cinquantaine de minutes a été adoubée comme celle qui séduit le plus), leur nombre et le nombre de saisons. Chacun peut se plonger dans son bonheur : depuis le discret ruisseau des mini séries jusqu’au long fleuve qui méandre au cours des années, dans l’humour ou la fantasy, la politique ou le polar… Les chaînes de télé et les plateformes, dont le parangon incontournable est actuellement Netflix[1], peuvent se frotter les mains, et leurs clients se frotter les yeux de plaisir en pensant à ce choix pharamineux qui leur est offert et à cet avenir, sans borne, d’aventures et de douces émotions, de rires francs et d’indignations tonifiantes.
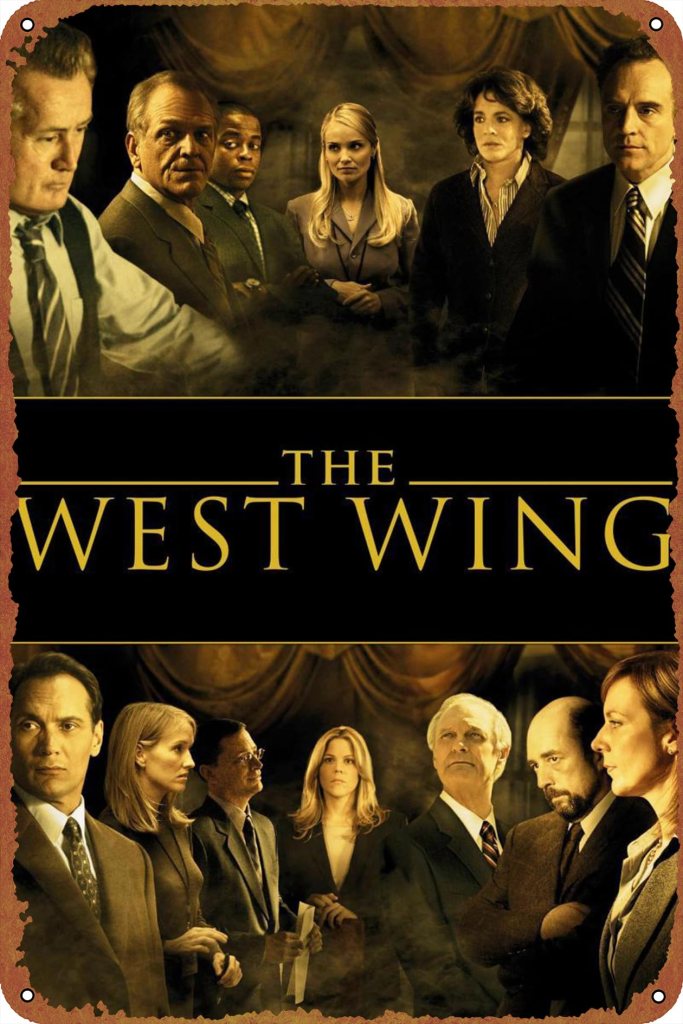
Ce qui est aussi remarquable, c’est que ce public d’aficionados peut de plus se sentir totalement épanoui, libéré des jugements de valeur qui ont longtemps frappé de mépris les téléspectateurs vissés devant leur petit écran. Dès 2016, Libération publiait par exemple une interview de la chercheuse Nathalie Camart, où celle-ci évoquait une « forte proportion de professions intellectuelles supérieures et d’étudiants » parmi les consommateurs de séries audiovisuelles ; et de nos jours les déclarations d’amour passionnel pour cette nouvelle forme de culture, voire cet « art majeur » du XXIe siècle, émanent des esprits les plus éclairés. Et ceux qui verraient de l’ironie dans mes propos se tromperaient très largement. Déjà en octobre 2013, Agnès Chauveau (spécialiste des médias, productrice radio, universitaire) écrivait dans le Huffington Post :
« Autrefois méprisées, considérées comme un genre mineur, les séries sont devenues un art dominant de notre époque, des référents culturels, sociaux, générationnels aussi important qu’un film, une musique ou un livre. Au point que dans certains milieux, le public éduqué, citadin, notamment, ne pas avoir vu The West Wing, The Wire, frôle la faute de goût. »
Il me semble intéressant de constater, en outre, que le phénomène en question ne concerne pas que les créations audiovisuelles, même si celles-ci lui confèrent une ampleur et une visibilité sans précédent. Le principe de la série et celui de la massification, bref l’importance déterminante du quantitatif (des produits culturels qui occupent un maximum de temps, d’espace et touchent un maximum d’êtres humains), semble constituer un idéal pour nombre de formes d’expression culturelle ou artistique.
Ainsi le cinéma – audiovisuel lui aussi, d’ailleurs, mais obéissant à d’autres configurations – connaît bien sûr ses suites, ses préquelles, ses propres séries et ses franchises (Mission impossible, Matrix, Fast and Furious… ou encore la franchise Marvel qui comporte plus de trente films).

La littérature n’est évidemment pas en reste avec les séries de romans ou de romans graphiques notamment. Et l’on passe souvent d’un domaine à l’autre (Harry Potter ou Millénium passés du livre au grand écran, Le Trône de fer passé du livre au petit écran, les romans de Jean-Philippe Jaworski adaptés en BD, etc.).
Le cas de la production musicale est différent mais rejoint clairement et naturellement, a-t-on envie de dire, cette caractéristique du quantitatif, du sériel, du massif, du répétitif. Les modes musicales (tel style, tel artiste…) débouchent sur une diffusion la plus abondante possible. Les plateformes musicales (Deezer, Spotify…) sont le pendant audio des Netflix et autres Disney+. Les « robinets à musique » déversent leurs flots sur les ondes radio en matraquant les mêmes titres des centaines de fois dans la semaine, et lorsqu’on parle chanson dans les médias, c’est très généralement pour s’extasier avant tout sur des nombres de ventes, de visionnages sur YouTube, et l’on établit des classements sur ces bases, sans s’intéresser le moins du monde à des caractéristiques artistiques, musicales ou – cela semblerait tout à fait incongru – au texte de la chanson.

Les Brigades du Tigre
Ces faits sont loin d’être nouveaux. Les séries, les feuilletons télévisés ou radiophoniques, ont été très populaires il y des décennies déjà, s’adressant aux adultes ou aux enfants. Selon le site de partage de connaissances Quora, la première série télé au monde serait anglaise : Pinwright´s Progress, diffusée par la BBC en 1946-1947. Les sexagénaires comme moi se souviennent des années 60 et 70, du Manège enchanté et de Belphégor, des Brigades du Tigre et des Shadocks, d’Amicalement vôtre et de Chapeau melon et bottes de cuir, et le désopilant Bons baisers de partout à la radio. Et puisqu’on parle de radio, le roman de Vargas Llosa, La Tante Julia et le scribouillard nous rappelle le succès colossal de ce type de feuilletons en Amérique latine il y a des lustres.
Dans la première moitié du XXe siècle, dans les publications imprimées, la loi des séries se trouvait aussi allègrement suivie, et avait été inaugurée au siècle précédent. De Balzac à Agatha Christie, en passant par Dickens ou Eugène Sue, les auteurs de feuilletons et/ou de romans sériels et autres sagas ont fait florès. Idem pour la bande dessinée, du Yellow Kid à Tintin. La recette et les objectifs sont souvent identiques : publier dans la presse en livraisons périodiques[2], fidéliser un lectorat, publier ensuite en volumes pour élargir encore le public, c’est-à-dire avant tout le nombre d’acheteurs. La présence d’un ou plusieurs personnages récurrents, auxquels le lecteur s’attache d’une manière ou d’une autre, est capitale : Sherlock Holmes ou Arsène Lupin, Little Nemo ou le capitaine Haddock, Rouletabille ou Fantomas…

Little Nemo in Slumberland (début du XXe siècle)
Mais notre machine à rembobiner le temps ne peut s’arrêter si vite. Et plus on remonte dans le temps, plus on finit par comprendre que les créations narratives obéissant à des principes comparables à ceux de nos séries et feuilletons d’aujourd’hui ont « toujours » été appréciées, et donc proposées. Dans les débuts du XVIIe siècle, Marin Le Roy de Gomberville participe à sa manière aux excès du baroque en rééditant et en dilatant son vaste roman héroïque Polexandre, répondant ainsi aux attentes de lecteurs qui, pendant vingt ans se passionnent pour les aventures débridées du héros. Avant lui le grand Rabelais joue aussi avec le principe de la série pour mieux « surfer » sur le succès. L’époque médiévale est marquée notamment par le cycle des romans de la Table Ronde, élaboré par tout un pool transfrontalier et transséculaire dont la vedette la plus connue et la plus prolifique est Chrétien de Troyes… avant Alexandre Astier et ses complices de Kaamelott ! Faut-il poursuivre en amont jusqu’aux aèdes grecs – avec Homère en tête de gondole – ou aux créateurs du Mahâbhârata ? Faire un large crochet dans le temps et l’espace pour évoquer les griots africains ?

de Chrétien de Troyes
Ces quelques exemples peuvent donc mettre en lumière ce qu’on pourrait considérer comme une féconde et très ancienne tradition associant dans un goût – et/ou un intérêt – commun les créateurs d’une part et d’autre part les auditeurs, lecteurs, spectateurs. Ce qui fait figure de nouveauté, c’est l’ampleur du phénomène – surtout dans l’audiovisuel bien sûr –, sa systématisation, une accessibilité facile et une disponibilité permanente pour des centaines de millions de personnes, l’impressionnante efficacité des moyens mis en œuvre pour que l’offre soit toujours plus performante et la demande toujours plus avide. Le binôme créateur-auditeur/lecteur/spectateur assume sans complexe sa mutation, sans solution de continuité, en une entité d’une nature sensiblement différente : producteur-consommateur.

de la série Kaamelott, inspirée par le cycle des romans du cycle arthurien
____________________________________________________________________
[1] Le 24 janvier 2024, L’Express titrait : 260 millions d’abonnés : Netflix, le leader de la « guerre du streaming ».
[2] Pratique fréquente mais non systématique.






Votre commentaire