Entre septembre 2024 et février 2025, trois films, écrits et réalisés par des artistes nés en Corse, ont permis de jeter un coup de projecteur sur le cinéma de l’Île de Beauté : À son image de Thierry de Peretti, Le Royaume de Julien Colonna et Le Mohican de Frédéric Farrucci. Dans le premier film, Thierry de Peretti (Une vie violente) adapte le roman éponyme de Jérôme Ferrari et nous plonge dans les années de plomb qui ont secoué le mouvement nationaliste corse, mais également l’ensemble de la population de l’île, durant les années 1980/1990. Le cinéaste a accepté de répondre à nos questions.
Interview dirigée par Lamia DIAB EL HARAKE et Gaëtan DESROIS.
Illustration de couverture : @ElisePinelli
CHEMINEZ : Bonjour Thierry. Nous avons découvert votre travail grâce à un article d’AlloCiné qui comparait des films dits « corses », et parmi lesquels figuraient deux de vos œuvres (Une vie violente et Les Apaches), au côté de comédies avec Didier Bourdon. Nous aimerions savoir si vous vous considérez comme un cinéaste corse, et quelles, selon vous, sont les conditions nécessaires à l’émergence d’un cinéma régional ?
THIERRY DE PERETTI : Je suis corse et je travaille en Corse. Mais je ne suis pas vraiment à l’aise avec l’appellation régionale. La Corse est une île avec un peuple, son histoire, sa culture, sa langue. Je ne fais pas non plus un cinéma national. Ce n’est pas mon projet. Je fais un cinéma qui s’inscrit dans une époque particulière sur un territoire donné.
Mes films sont soutenus par la Collectivité de Corse, mais aussi par l’avance sur recettes du CNC, Canal+ et Arte. Les financements ne sont pas exclusivement corses bien sûr. Vous soulez une question intéressante : pourquoi, en tant que spectateur de cinéma, je ne vois pas davantage de films contemporains émerger d’autres territoires en France ? Je suis étonné de ne pas voir plus de films – même s’il y en a tout de même – venir de La Réunion par exemple, de Kanakie ou de Martinique, ce sont des îles aussi et marquées par une grande intensité politique dernièrement.

Pour qu’un cinéma émerge, il faut des cinéastes. On ne peut pas pousser des personnes à avoir envie de filmer. La question dans le cinéma de fiction, c’est celle des récits et des personnages qui les portent, les incarnent. Mais pas seulement au cinéma. En Corse, il y a aussi des artistes, des romanciers, des photographes… également connectés et soucieux de la réalité contemporaine de l’ile et qui contribuent à faire émerger de nouveaux récits. Nous vivons sur un petit territoire, donc nous nous connaissons tous, nous connaissons nos travaux respectifs, les idées circulent.
Vous avez évoqué la comédie d’Éric Fraticelli, qui est un ami et aussi un acteur que j’aime beaucoup – nous avons commencé ensemble. Nos films sont très différents c’est vrai, mais nous travaillons dans le même moment en Corse.
CHEMINEZ : Parlez-vous le corse ?
THIERRY DE PERETTI : Très mal. J’ai un rapport ambivalent à la langue, comme beaucoup de gens de ma génération en Corse. La langue a été investie politiquement dès les années 70 par les nationalistes. Puis instrumentalisée, d’une certaine manière.
C’est le Riacquistu (littéralement «la ré-appropriation »), mouvement culturel essentiel de ces années-là portés par les militants culturels corses, qui a œuvré pour que le peuple se ressaisisse de ses droits historiques, politiques et culturels, et bien sûr pour ses acteurs, cela passait avant tout par la langue.
La génération de mes grands-parents n’avait plus le droit de parler le corse, qui était leur langue, en dehors de la sphère privée. Mes grands-parents parlaient corse entre eux, mais ne me l’ont pas transmis. J’ai grandi dans cette langue, mais je ne l’ai pas apprise. Je dois dire que jeune homme, l’importance politique et idéologique que lui donnaient les mouvements autonomistes m’a rebuté, car je le ressentais comme une injonction implacable. Je m’intéressais davantage à la culture de mon époque qu’à celle que je percevais comme plus ancienne.
En revanche, les jeunes qui ont travaillé sur mon film sont tous bilingues, et ils parlent corse entre eux bien plus que beaucoup de gens de ma génération.
CHEMINEZ : En parlant des jeunes hommes et des jeunes femmes de votre film, il y a une scène dans À son image qui nous a beaucoup marqué. Antonia tente de justifier auprès de son patron sa présence au procès des membres du FLNC en mettant en évidence un paradoxe : bien que cela concerne la Corse, les médias corses sont contraints de déléguer à d’autres la possibilité d’y assister et d’en parler. Est-ce parce que vous souscrivez à cette réflexion d’Antonia que vous choisissez des acteurs corses et débutants pour incarner la jeunesse de l’île ?
THIERRY DE PERETTI : Je souscris à ce qu’Antonia dit, mais d’une certaine manière aussi à ce que son rédacteur en chef avance, même si son discours me semble paternaliste et limité. Antonia se rendra peu à peu compte que c’est sur ce qui lui est le plus proche, le plus intime qu’elle peut porter le regard le plus juste. Filmer ou photographier chez soi, les siens, en connaissant intimement ce qu’on montre, permet de donner à voir ce qui n’a pas été mille fois vu. Travailler avec des acteurs corses me semble essentiel. Et puis surtout, c’est avec eux que j’ai envie de travailler, car c’est d’abord une question de désir.
Faire du cinéma est coûteux et on est poussé souvent à choisir des vedettes, mais pour mes films cela n’aurait pas de sens et serait politiquement discutable. Le scénario n’est jamais définitif avant que je rencontre les acteurs. Il sert comme base, mais c’est lors des rencontres avec les actrices et acteurs, avec Julie Allione, la directrice de casting, que quelque chose prend forme.

Je fais résolument un cinéma de fiction, mais mes films sont traversés par les questions documentaires. Cependant je ne fais plus de distinction entre fiction et documentaire depuis longtemps. Je trouve que cette distinction est devenue obsolète et qu’elle relève surtout des critères de financement : demande-t-on une aide à un guichet documentaire ou bien au guichet fiction ? Le cinéma contemporain a aboli cette frontière.
C’est un point essentiel pour moi notamment dans À son image, qui est une évocation des années 1980/1990, mais qui montre bien qu’elle se fait à partir de notre époque, de la Corse d’aujourd’hui. Le cinéma existe en Corse depuis les débuts du cinéma, mais le peuple et la culture corses, comme beaucoup d’autres, ont été invisibilisés par le cinéma de fiction pendant longtemps. Si je fais des films ici il est évident que je choisirai des acteurs corses pour incarner les personnages du récit. C’est une question politique, mais aussi de justesse et de langage.
Mes films sont en français, même s’il y a pas mal de corse dans les dialogues. Mais le français que parlent les personnages est un autre français. Je m’en rends compte lors des improvisations qu’on fait durant les sessions de casting : si lors d’un essai, on mélange des acteurs corses et non corses, l’improvisation ne fonctionne pas, même s’ils parlent la même langue, car les mots que chacun utilise ne désignent pas les mêmes choses. C’est frappant. Et quand les mots ne désignent plus la même chose, jouer ensemble devient difficile. Les acteurs ne se comprennent plus vraiment, n’arrivent même plus à s’écouter et donc ne peuvent plus jouer ensemble, même s’ils ne s’en rendent pas forcément compte. Pour moi, ça révèle un fossé culturel et des mémoires collectives absolument différentes.
CHEMINEZ : Nous avons eu une conversation avec des membres de la communauté sourde à propos du film La Famille Bélier, et ils nous ont expliqué que le film avait été très mal reçu par cette communauté. Selon eux, le problème venait du fait que les acteurs étaient entendants, alors que les sourds avaient besoin d’être véritablement représentés. De plus, ils nous confiaient que, bien que les acteurs entendants aient appris à bien maîtriser les signes, l’expressivité du visage – qui est essentielle dans la langue des signes française – était absente.
THIERRY DE PERETTI : Bien sûr, ce sont des questionnements très contemporains, et ils ne touchent pas seulement les représentations liées à la Corse. En 2025, un spectateur attentif a peut-être de plus grandes attentes ou exigences sur ces questions-là qu’il y a dix ou vingt ans. Mais il faut se méfier : si on pousse cette logique jusqu’au bout, les enjeux idéologiques prennent le dessus et inhibent totalement. D’abord, il y a des enjeux d’image. En Corse, je vois bien les discours qui disent : « Ça donne une bonne ou une mauvaise image de nous ». Je ne crois pas qu’on doive se soucier de ce genre de choses.

On entend aussi l’argument : « Un acteur est un acteur, il peut tout jouer ». Oui, mais en 2025, la question se pose différemment. Je suis particulièrement sensible à cela parce que je viens d’un endroit où l’imaginaire a été façonné, influencé par tout un folklore colonial. Aujourd’hui, cela me semble essentiel : non pas de dynamiter le folklore, mais de parler nous-mêmes de nous. C’est ce que dit Antonia dans À son image : « On va laisser les médias nationaux parler de ce qui nous concerne nous ? » Donc, c’est quoi notre utilité ? On est réduits aux sujets les moins intéressants, ceux qui attirent peu de lecteurs et donc peu d’argent. ». Car les enjeux sont aussi économiques, naturellement.
CHEMINEZ : Nous avons trouvé les jeunes acteurs absolument remarquables dans vos films. Par exemple, la jeune actrice qui joue Antonia est éclatante à l’écran. Votre démarche artistique soulève également une question intéressante : comment donner une chance à ces jeunes de pénétrer dans le monde du cinéma sans passer par un parcours tout tracé ?
THIERRY DE PERETTI : Je suis content que vous soyez sensibles à cela, car ça compte beaucoup pour moi.
Ce que je cherche d’abord, ce sont des personnes qui ont un instinct de jeu très fort tout en étant connectées à la réalité du territoire où se déroule le film. Si des acteurs corses connus répondaient à ces critères, je n’aurais pas hésité et cela m’aurait d’ailleurs facilité la vie sur de nombreux aspects !
CHEMINEZ : Dans Une vie violente et À son image, vous abordez les années de plomb du mouvement nationaliste corse. Est-ce que votre intention est de montrer l’envers de cette mythologie en mettant en lumière le coût humain de la lutte armée, ou bien cherchez-vous à dresser le bilan de cette période en révélant ce qu’elle a en commun avec la jeunesse nationaliste d’aujourd’hui ?
THIERRY DE PERETTI : Sans doute les deux. Je fais des films en Corse, mais mes films ne s’adressent pas uniquement aux corses. Je sais en les faisant qu’il y a cette double adresse. Cependant, j’évite la pédagogie, ce n’est pas mon projet. Et cela peut m’être reproché. Ce qui m’intéresse avant tout, ce sont les personnages et de filmer et montrer le monde dans lequel ils vivent et évoluent.
Les années de plomb, c’est une période dont on continue de subir les conséquences douloureuses, car le bilan n’en a pas été fait, du moins pas au cinéma. Je m’interroge moi-même sur les limites de la radicalité politique. Je ne dis pas qu’elle n’a pas été utile à un moment donné, mais il est nécessaire de regarder franchement ses dérives, ses limites et son impact sur la société, plus de trente ans plus tard.

La violence politique a surgi en Corse au moment où l’île, laissée totalement à l’abandon par le pouvoir central, se trouvait dans une situation économique, sociale, culturelle et même démographique catastrophique. Il n’y a pas d’autres exemples d’un tel abandon, d’une telle mise à l’écart dans le reste de la République. Les rares projets que la France avait pour la Corse étaient aberrants, injustes, criminels, même. Je pense aux tentatives d’essais nucléaires au large du Désert des Agriates, ou au don unilatéral des terres les plus cultivables de Corse à une partie des pieds-noirs rapatriés d’Algérie. Et tout cela alors que la Corse avait payé un lourd tribut pendant les deux Guerres mondiales. Dans les années 50/60, il n’y avait pas en Corse de routes dignes de ce nom, pas d’université, et aucun corse ne pouvait obtenir de prêt des établissements bancaires pour quel que projet que ce soit. De la résignation on est passé à de la colère et un profond sentiment d’injustice. Mais les luttes pour l’autodétermination ne sont pas propres à la Corse, elles étaient présentes partout dans le monde à cette époque.
CHEMINEZ : Dans Une vie violente, le personnage de Stéphane cite Franz Fanon dans Les Damnés de la Terre. Avez-vous inclus cette citation pour documenter les fondements de la pensée du FLNC, ou est-ce parce que vous comprenez intellectuellement des actions que vous réprouvez peut-être ?
THIERRY DE PERETTI : Les deux. C’est vrai que Frantz Fanon était une référence pour certains militants du FLNC, en particulier en prison. Ce sont des textes qui me touchent profondément, à la fois par leur grande force politique et aussi une forme de clarté poétique.
À cette époque, les militants en prison ne lisaient quand même pas tous Fanon, mais le personnage principal, Stéphane, qui sait que la lutte nationaliste en Corse a pu s’en nourrir à un moment, fait le choix de se tourner vers cette pensée-là. Cependant il va vite se rendre compte que cette pensée est presque trop vaste, car, la lutte des chefs, la lutte politicienne, existe aussi violemment au sein des mouvements clandestins. La guerre des chefs et des égos, comme on peut la voir dans le monde politique, se retrouve bien sûr dans la clandestinité, et il suffit d’un peu de manipulation pour que la situation échappe à tout contrôle.
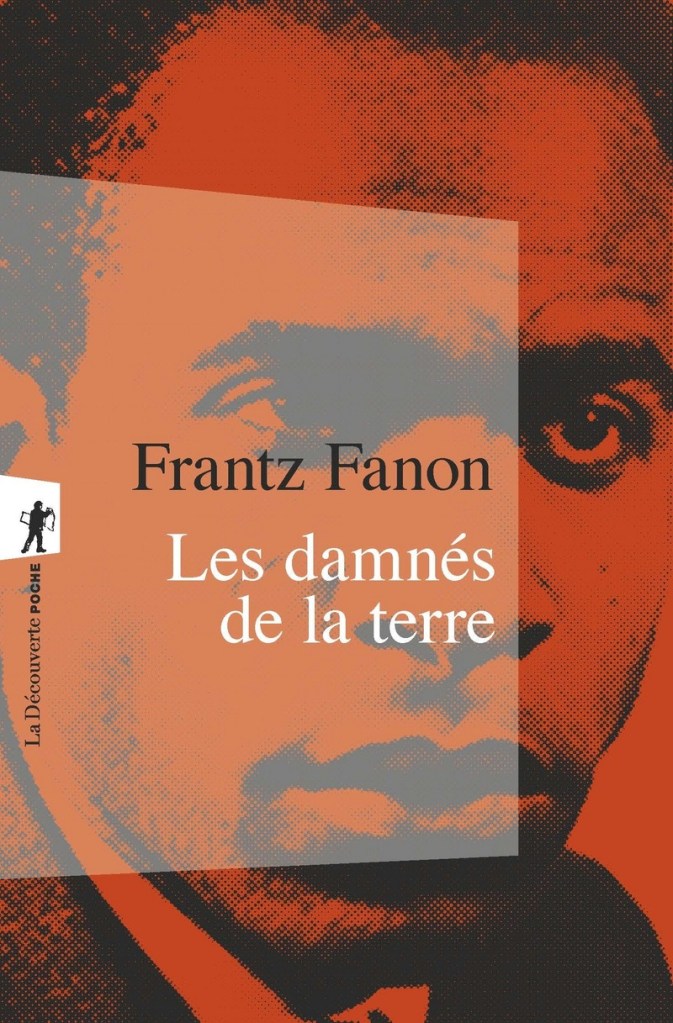
Fanon, c’était essentiel pour moi de le placer au cœur du film. Il fallait que Stéphane le découvre. En particulier parce que Fanon n’a jamais pensé à la Corse, et cela fait du bien de se dire qu’il y a aussi d’autres luttes dans le monde !
CHEMINEZ : Votre cinéma évoque souvent la période des années de plomb. Que reste-t-il de ces années aujourd’hui ? La société corse a-t-elle commencé à travailler sur cette mémoire ? Et pensez-vous que votre cinéma participe à ce travail de mémoire concernant une période difficile pour beaucoup de personnes ?
THIERRY DE PERETTI : J’ai envie de répondre oui et non. Oui, il y a un travail d’introspection qui se fait petit à petit, pas à pas. Mais ce n’est pas non plus le grand bilan auquel on aurait pu s’attendre. Il se fait de manière progressive, et surtout par des artistes, des écrivains, des cinéastes, bien plus que par les responsables politiques ou les journalistes. Ceux-ci, souvent, se contentent d’un constat assez noir, mais très global « Oui, ça a été très dur », puis on referme le sujet et on en parle peu. Ce qui est compréhensible, car de nombreuses personnes ont été touchées, impliquées, et certains responsables politiques de premier plan ont sans doute été eux-mêmes très concernés par les événements.
CHEMINEZ : Vous êtes à la fois cinéaste et acteur. Dans À son image, vous endossez les deux rôles, en tant que réalisateur et en tant qu’acteur, en interprétant l’oncle et parrain d’Antonia. Qu’est-ce qui vous a poussé à jouer ce rôle ?
THIERRY DE PERETTI : Ça fait partie des choix qui se font avec les personnes avec qui je travaille, notamment Julie Allione, la directrice de casting de mes films. Cela me fait très plaisir d’être parmi la troupe de jeunes actrices, il y a peut-être comme un passage de relais qui s’opère. Mais j’essaie vraiment de m’inscrire comme un acteur parmi les autres. L’important, c’est que la distribution soit juste, que mon rôle n’éclipse pas le reste. Quand un réalisateur joue dans son propre film, on cherche toujours à en déceler une signification cachée. Il y en a sûrement une, mais la principale, pour moi, c’est que ça sonne juste au sein de la troupe.
CHEMINEZ : On a l’impression que l’oncle d’Antonia se rapproche beaucoup de vos interrogations et de vos idées vis-à-vis de cette période.
THIERRY DE PERETTI : C’est presque un hasard. Ce que vous évoquez, c’est d’ailleurs l’une des raisons qui aurait pu m’empêcher de jouer ce rôle. Je ne suis pas à l’aise avec l’idée que les personnages soient réduits à une idée ou semblent n’être là que porter un discours, une intention. Ils doivent être des personnages avant tout. Je partage surement certaines des positions de ce personnage, mais ce n’est pas ce qui compte. Je veux dire, ce n’est pas pour cela que j’ai voulu le jouer. Ses idées, ce qu’il défend, n’appartiennent qu’à lui seul.
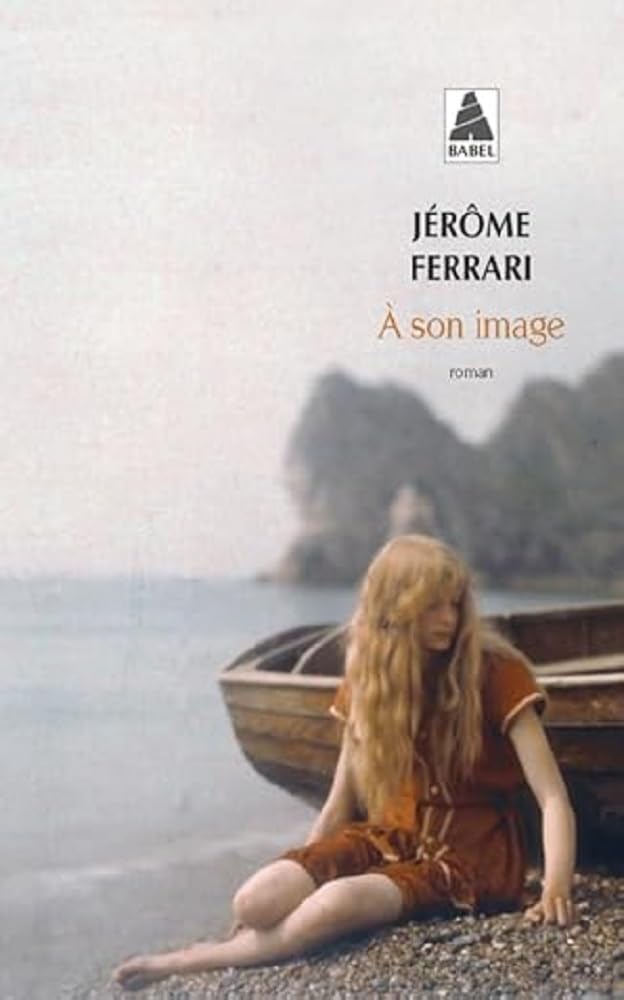
CHEMINEZ : À propos de ce personnage, le processus d’adaptation du roman de Jérôme Ferrari nous a beaucoup intéressés, notamment en ce qui concerne la présence de la religion. Dans le roman original, la religion joue un rôle plus central et le prêtre, par son attitude envers ses paroissiens, est vu sous un angle très critique. On a l’impression que dans le film, ce regard négatif sur le personnage est atténué. Est-ce un choix de votre part pour illustrer, peut-être, une réalité en Corse, à savoir que la religion peut aussi servir de garde-fou en période de turbulences ?
THIERRY DE PERETTI : Personnellement, j’ai une lecture différente de la vôtre, car je n’ai pas trouvé que Jérôme Ferrari pose un regard particulièrement dur sur lui. Ce qui m’a touché c’est à la fois sa radicalité, son obsession de la vérité, mais aussi le fait que c’est un prêtre ancré dans la vie pastorale, normal quoi. Il est prêtre, mais il aurait pu être médecin, journaliste, prof. La culture catholique est forte en Corse, pourtant je ne dirais pas que ça soit plus fervent qu’ailleurs. Ce qui diffère c’est que cette culture se teinte aussi d’une forme de paganisme, mais aussi de laïcité. Cela crée un mélange étrange, une impureté, mais qui me plait.
Aujourd’hui, il y a une génération de jeunes prêtres qui créent peut-être une forme de ferveur supplémentaire, mais cela reste assez récent. Cela dit, je n’ai pas l’impression que la question de la religion soit vraiment au cœur du film.
CHEMINEZ : La bande originale d’À son image est très intéressante, avec des morceaux aussi divers que des chants nationalistes corses, l’hymne punk Salut à toi des Bérurier Noir, et du raï algérien. Comment avez-vous fait vos choix musicaux ?
THIERRY DE PERETTI : C’est un processus qui s’engage dès l’écriture du film et qui se poursuit jusqu’à la fin du montage. La playlist qui s’assemble au fur et à mesure m’offre une possibilité de raconter le film autrement. Il y a plusieurs films dans un film, plusieurs façons de raconter. Dans À son image, il y a ce qu’on voit à l’image, il y a la voix off – des morceaux du roman qui se sont dissous dans le film -, et enfin il y a la musique. Parfois, la musique propulse l’image ailleurs, parfois elle se fond avec elle, et parfois elle devient complètement dissonante. Elle est indépendante de l’image. C’est un comme un set qui se fait en direct sur l’image, comme si le film était muet.
Je travaille avec Frédéric Junqua qui est le superviseur musical de mes films depuis Une vie violente. Dès le moment où je commence à écrire, on se met à échanger pas mal de musiques, on constitue de nombreuses playslists, certaines liées à l’époque que le film couvre, mais aussi des tapis, des titres qu’on collectionne tout au long du processus, de manière à échanger, réfléchir ensemble et établir un principe musical appartenant en propre au film qui se construit peu à peu. Ensuite, dans la phase de fabrication, on essaie beaucoup, des sons, titres, ambiances – jusqu’à très tard pendant le montage. Le morceau de raï algérien que vous mentionnez est un morceau de Cheb Hasni. C’est un artiste que j’aime beaucoup, il a été tué très jeune par des islamistes radicaux dans les années 1990. C’était un militant politique, mais il chantait presque uniquement des chansons d’amour. J’ai choisi ce morceau parce qu’il me touche particulièrement mais aussi parce qu’il fait écho à la décennie noire algérienne des années 1990. Cela établit des liens entre un territoire et un autre, de la même manière qu’il y a dans le film cette partie en ex-Yougoslavie et la Corse. Je cherche à faire des passerelles, des effets de montage qui créent un récit souterrain.






Votre commentaire