Dans Allons enfants de la Guyane, la journaliste Hélène Ferrarini plonge dans un véritable scandale d’État et raconte comment des enfants autochtones de Guyane ont été séparés de leurs famille pour être francisés de force dans des instituts catholiques, et dans une France qui affiche fièrement son statut de République laïque. Ce faisant, elle raconte une autre Histoire de la colonisation, de la République et de la laïcité. Une enquête passionnante et fondamentale ! Hélène Ferrarini a accepté de répondre à nos nombreuses questions.
Propos recueillis par Lamia DIAB EL HARAKE et Gaëtan DESROIS
CHEMINEZ : Bonjour Hélène Ferrarini, merci au nom de la rédaction de Cheminez d’avoir accepté de répondre à nos questions. Pourrais-tu te présenter pour nos lecteurs qui ne te connaitraient pas encore ?
Hélène FERRARINI : Bonjour, je m’appelle Hélène Ferrarini. J’ai un Master de recherches en Histoire – ce qui fait que j’ai une certaine appétence pour la perspective historique – et je suis journaliste et autrice. Je travaille sur la Guyane depuis une quinzaine d’années, que j’analyse sous un angle historique.
CHEMINEZ : Tu as publié en 2022 un livre qui s’intitule Allons enfants de la Guyane, un ouvrage dans lequel tu révèles l’existence des « homes indiens ». Est-ce que tu pourrais présenter ces instituts ?
Hélène FERRARINI : Ce qu’on appelle en Guyane des « homes indiens », ce sont des pensionnats, des internats, gérés par le clergé catholique – des prêtres et des religieuses –, spécifiquement destinés aux enfants des populations autochtones et Noires-Maronnes de Guyane. Il y en a eu huit sur le territoire d’après ce que j’ai pu trouver au cours de mes recherches. Ils apparaissent dans les années 1930 à l’initiative des religieux, et sont soutenus peu de temps après par l’État français – après la Départementalisation de 1946 –, et plus particulièrement par la Préfecture de Guyane. Je dois préciser que le dernier home en activité, celui de Saint-Georges-de-l’Oyapock, a fermé ses portes en 2023.

CHEMINEZ : 2023, c’est très récent. Qu’est-ce que ces homes disent de notre rapport à la laïcité et à la colonisation ? Pourquoi selon toi la France se mêle-t-elle des affaires des autochtones ? Pourquoi cette volonté de « franciser », d’évangéliser ces populations ?
Hélène FERRARINI : En Guyane, la République est en contradiction avec plusieurs de ses valeurs et fondamentaux. La loi de séparation de l’Église et de l’État de 1905 ne s’applique pas sur le territoire ; suite à l’ordonnance royale de Charles X datant de 1828, qui régit les relations entre l’État et le clergé en Guyane, les membres du clergé sont des salariés de l’autorité publique ; ils ont d’abord été sous la tutelle du ministère des Colonies, avant d’être à la charge directement de la collectivité territoriale de la Guyane. C’est un statut de type concordataire, et c’est toujours le cas aujourd’hui. Il y a des liens très forts entre l’Église et l’État en Guyane.
Au moment de la Départementalisation de 1946, la question de l’application de la loi de 1905 s’est posée, et il a été choisi – notamment par le ministre de l’Intérieur de l’époque – de ne pas appliquer cette loi et de rester au contraire sur cet ancien régime de l’ordonnance royale de 1828. Dans une lettre, dans laquelle il explique que l’État français va continuer à rétribuer le clergé catholique guyanais, le ministre de l’intérieur de l’époque Jules Moch explique que la Guyane est toujours considérée « comme une terre de mission parmi les infidèles ». Les infidèles sont, dans ce contexte, ceux que l’Église qualifie de païens et que l’administration considère comme des « populations primitives », c’est-à-dire les autochtones – les descendants des premiers habitants d’avant la colonisation, que l’on appelle aussi Amérindiens – et les Noirs-Marrons – les descendants d’esclaves qui se sont rebellés, ont résisté et ont réussi à créer des sociétés libres en forêt. Ces deux populations, qui sont les plus rétives, les résistantes, à la colonisation et à l’assimilation, sont spécifiquement visées par les « homes indiens ».

Une des conclusions à laquelle je suis parvenue en faisant toutes ces recherches, c’est qu’il y a une persistance du rapport colonial entre la métropole – la France hexagonale – et la Guyane. Les homes indiens sont typiquement une politique que je qualifie désormais de « ciblage ethnique », dans la mesure où elle vise spécifiquement des populations particulières, et que tout le monde n’est donc pas concerné par ces internats. Même des enfants qui, vivant dans des endroits très éloignés des centres urbains, peuvent rencontrer des difficultés pour accéder à l’école, n’ont pas l’obligation d’aller dans ces établissements, alors que la question de l’accès à l’éducation était l’une des justifications des homes. Tandis que pour les enfants autochtones du littoral, c’était obligatoire.
Le littoral de la Guyane est colonisé par la France depuis le le XVIIème siècle – Cayenne, notamment. Au cours de ces quatre siècles de colonisation, il y a toujours eu du côté des autorités françaises, la question : « Que devons-nous faire avec les populations autochtones amérindiennes ? » Des historiens et des anthropologues expliquent qu’aux XVIIème et XVIIIème siiècles, durant les premiers temps de la colonisation française, les amérindiens étaient indispensables à la colonisation parce qu’ils ravitaillaient la colonie en hamac, en nourriture, en gibier, en poissons, en artisanat. Il fallait donc composer avec eux. Ces débuts de la colonisation furent également ceux des résistances les plus fortes de la part des Amérindiens, notamment du peuple Kali’na qui s’est battu contre les colons.
Au XIXème siècle, les populations autochtones ont vu leur démographie chuter, notamment du fait du choc microbien. Les individus n’étaient pas immunisés contre les maladies qui circulaient beaucoup en Europe. Il y a donc eu beaucoup de décès, et les populations ont commencé à se replier soit vers l’intérieur forestier, soit vers des zones moins sous contrôle de la colonie. Puis est venu le XXème siècle, le temps de l’assimilation et de l’intégration forcées à la citoyenneté française.
CHEMINEZ : On a pu apprendre dans ton livre que l’un des objectifs des homes indiens était de franciser les populations autochtones, et cela passait notamment par l’injonction à abandonner la langue maternelle au profit du français. Juste pour l’exercice de l’interview, nous sommes contraints de nous faire l’avocat du Diable. L’article 2 de la Constitution de la Vème République stipule que le français est la langue de la République. Est-ce que cet article de la constitution peut justifier que l’on force des populations autochtones à apprendre le français d’une part, et si oui, est-ce que le problème des homes indiens n’est pas en partie un problème constitutionnel ?
Hélène FERRARINI : C’est une question intéressante. J’imagine que cet article a servi de justification pour les autorités préfectorales de l’époque, qui ont avalisé ce système de homes, et qui ont vivement encouragé l’imposition du français par la création de lieux de « francisation ». Personnellement, en tant que citoyenne qui réfléchit à cette situation, je déplore que cela ait été imposé de force. C’est un problème qui se pose encore en Guyane : il y a toujours des populations autochtones qui fréquentent l’école française, où sont appliqués les programmes nationaux complètement en décalage avec la réalité géographique, historique, sociologique, des gens présents en Guyane.

Les langues autochtones ont réussi à se faire une petite place au sein de l’Éducation nationale, dont la langue est encore le français, avec ce qu’on appelle des « intervenants en langue maternelle » (ou I.L.M.), dont l’objectif n’est pas de permettre aux enfants de se construire dans leur langue maternelle, mais plutôt de faire entrer les enfants dans la langue française et de jouer un rôle d’accompagnement dans la francisation. L’objectif final est bien de parler en français, de maîtriser le français, de passer les examens scolaires en français.
CHEMINEZ : On suit ce qui s’est fait en métropole, et il y a eu les mêmes histoires en Occitanie, en Bretagne, en Alsace. Tu as les mêmes comportements de l’État français, qui vise à empêcher les enfants à parler leur langue maternelle.
Hélène FERRARINI : Oui, avec une idée qui ferait du français une langue au-dessus des autres langues. Je me dis qu’on pourrait envisager une cohabitation de toutes ces langues. La Guyane est plurilingue. Quasiment tous les enfants de Guyane parlent au moins deux ou trois langues, et en fonction du contexte ils vont passer d’une langue à l’autre. Des linguistes ont effectué des travaux dessus. Mais dans l’Éducation nationale, il y a une domination du français. Les rapports avec l’administration française – qu’on peut qualifier d’administration coloniale en Guyane – sont en français. Et même pour des gens dont la présence sur ce territoire remonte à bien avant l’arrivée des premiers colons. La langue Kali’na n’est pas une langue avec laquelle l’administration française accepte de composer.

CHEMINEZ : Tu évoquais d’ailleurs les programmes scolaires, on peut complètement faire un lien avec les manuels des missions durant la colonisation en Afrique, avec cette phrase que les populations africaines devaient apprendre : « nos ancêtres les gaulois ».
Hélène FERRARINI : C’est ce que rapportent les anciens pensionnaires des homes indiens : ils ont appris le nom des fleuves de l’Hexagone, mais on ne leur a pas appris le nom des fleuves qui traversent la Guyane. Je travaille actuellement sur un documentaire historique pour France Télévisions sur l’Histoire des homes, et qui donnera une belle part aux images d’archives ; j’ai trouvé une photographie où on voit un instituteur en Guyane dans les années 1950, qui fait la classe à trois petites filles amérindiennes en kalimbé ; on voit une belle carte de l’Hexagone.
CHEMINEZ : Cette anecdote est très intéressante, parce qu’en plus du problème constitutionnel que l’on a évoqué, il y a aussi un problème philosophique en France dans la conception de la nation. Est-ce qu’il n’y a qu’une seule nation en France ? est-ce que toute personne qui nait et qui habite durablement sur le territoire français est française ? Par exemple, est-ce qu’un autochtone guyanais, né dans un département français d’outre-mer, a la vocation d’être français ? C’est une question philosophique qui se pose. J’ai l’impression que ça a aussi un lien avec la problématique des home indiens.
Hélène FERRARINI : Toutes ces politiques publiques sont déployées avec une très grande méconnaissance de la Guyane. L’Académie guyanaise repose en grande partie sur des enseignants contractuels qui débarquent chaque mois de septembre pour remplir les effectifs, alors qu’ils n’ont jamais mis les pieds en Guyane, ne connaissent rien du contexte guyanais. Du jour au lendemain, ils se mettent à enseigner à des élèves sans connaissance, et parfois sans considération, pour le contexte culturel dans lequel ils s’inscrivent.
Au cours du XXème siècle, il y a eu des débats autour de cette question du statut des populations autochtones en Guyane : ils n’ont pas acquis la citoyenneté française immédiatement après la départementalisation de 1946, c’est arrivé progressivement dans les années 1960 – sans qu’on laisse le choix aux autochtones –, voire plus tardivement encore pour ceux qui résidaient dans des zones plus reculées à l’intérieur de la Guyane – plutôt dans les années 1970-1980 et jusqu’aux années 2000.

Pour les populations autochtones et Noires-Maronnes, il y a eu l’établissement de l’État Civil. Chargés de cette mission, les gendarmes relevaient les prénoms et les noms, et les francisaient fréquemment. C’est pour cette raison qu’il y a aujourd’hui beaucoup d’Amérindiens dont les patronymes sont Jean-Baptiste, Pierre, Apollinaire ou Monnerville.
D’autres problèmes concernant les liens de parenté sont apparus, parce qu’entre les langues et les cultures, ces liens ne sont pas forcément synonymes : quelqu’un qui dit que telle personne est son frère ne signifie pas nécessairement qu’il est son frère tel qu’on l’entend en français ; cela a donné lieu à des imbroglios qui restent irrésolus aujourd’hui.
CHEMINEZ : On te posait cette question sur la philosophie de la nationalité en ayant en tête le fait que la France fait une confusion entre les mots « patrie » et « nation », alors que ce sont deux choses complètement différentes, comme le revendique l’ONU. Dans une seule patrie, il peut y avoir plusieurs nations.
Hélène FERRARINI : Les Amérindiens de Guyane se battent pour que la France reconnaisse les droits autochtones en signant la Convention 169 de l’Organisation Internationale du Travail (l’O.I.T.). C’est l’un de leurs plus grands combats, parce qu’en faisant cela, la France reconnaitrait l’existence de peuples autochtones sur son territoire. Même si ces peuples seraient français, il y aurait la reconnaissance de la coexistence entre plusieurs peuples. C’est une demande régulière des militants amérindiens de Guyane, mais ils se heurtent à un problème constitutionnel…

J’insiste : la République est souvent en profonde contradiction avec elle-même ; l’existence même des homes indiens repose sur la reconnaissance d’une identité spécifique, puisque les enfants qui sont concernés par les homes ne sont pas tous les enfants de Guyane, mais uniquement les enfants amérindiens et noirs-marrons. Ces politiques publiques impliquent qu’à un certain moment, la République a bel et bien connaissance d’identités spécifiques, et ce même si elle refuse de reconnaître officiellement leurs spécificités.
CHEMINEZ : Est-ce que les Guyanais « blancs » connaissaient l’existence des homes indiens ? Un de nos rédacteurs, Philippe Pratx, a enseigné en Guyane, et n’avait pas du tout connaissance des homes indiens, alors qu’il est très sensible à toutes ces questions autour des langues et des cultures.
Hélène FERRARINI : L’affaire sort à peine de l’ombre et du silence. La sortie d’Allons enfants de la Guyane a été un moment déclencheur, pour aborder cette histoire. Je ne suis donc pas surprise que des personnes qui connaissent bien la Guyane, qui ont pu s’y intéresser, soient passées à côté de l’histoire de ces établissements.

A partir de 1980, il ne restait que deux homes en activité : celui de Maripasoula sur le fleuve Maroni (fermé en 2012) et celui de Saint-Georges-de-l’Oyapock (fermé en 2023) ; c’étaient des établissements dont on parlait peu, voire pas du tout. Bien sûr les anciens pensionnaires qui étaient passés par là savaient très bien qu’ils avaient grandi chez des prêtres ou des sœurs ; dans les bourgs du littoral, où il y avait eu des homes indiens (Iracoubo, Sinnamary, Mana et Saint-Laurent-du-Maroni), les gens du coin se rappelaient qu’ici des enfants autochtones avaient grandi chez le prêtre ou la religieuse. Mais pour en avoir connaissance, il fallait y être « associé », soit en l’ayant vécu personnellement, soit en étant voisin de ce type d’établissement.
CHEMINEZ : On imagine que le ciblage ethnique que tu évoquais tout à l’heure est fortement lié à cette méconnaissance.
Hélène FERRARINI : Oui, tout à fait ! C’est une histoire principalement amérindienne et noire-maronne. Ce sont des générations entières qui sont passées par ces établissements. Pour les Kali’na du littoral, ils sont quasiment tous passés par des homes. Mais il me semble que les gens n’en parlaient pas tant que cela.
CHEMINEZ : Une demande de création d’une commission vérité et réconciliation a été déposée en février 2024. Est-ce que tu peux nous en parler ? Qu’est-ce qu’une commission vérité, quel est son rôle, quelles sont ses perspectives ?
Hélène FERRARINI : Je vais vous répondre au mieux, mais pour que vos lecteurs comprennent d’où je parle, permettez-moi de faire d’emblée une petite précision : je ne suis pas la cheville ouvrière de cette commission ; j’ai été associée à différents travaux, et je suis cela de relativement près.
Lorsque Allons enfants de la Guyane est sorti en 2022, le livre a intéressé du monde en Guyane et au-delà, les gens ont commencé à en parler ; en février 2023, un collectif pour la mémoire des homes s’est formé en Guyane, dont les membres fondateurs sont toutes et tous d’anciens pensionnaires de ces établissements. Ce collectif a ensuite demandé à l’Institut Louis Joinet – une association spécialisée dans la Justice Transitionnelle – de réfléchir à la pertinence d’ouvrir une commission vérité et réconciliation sur le sujet des homes d’enfants de Guyane. Le 1er février 2024, l’institut Joinet a présenté son rapport, concluant à l’intérêt de mener une commission sur un sujet comme celui-ci.

Une commission vérité et réconciliation c’est un terme assez large pour définir un cadre dans lequel un passé violent, traumatique, peut être abordé en toute sécurité pour les personnes qui témoignent, afin de tirer au clair ce qui s’est passé, d’établir des faits.
Mais cette commission n’est pas un tribunal. Ils ne vont pas conclure à une condamnation et à des sentences, mais ils vont essayer de dire et d’écrire, en recueillant la parole de toutes les personnes qui souhaitent s’exprimer, l’histoire des homes indiens : qu’est-ce qu’il s’est passé ? de quelle manière ? comment cela a été reçu par les principaux concernés ?
Idéalement, la commission peut être faite dans la langue que choisissent les gens, ce qui demande une ingénierie linguistique importante, comme me l’ont rapporté les responsables de l’Institut Joinet. Il n’y a pas de modèle préétabli, ce sont les personnes qui s’exprimeront à la commission qui devront définir son mode de fonctionnement.
Pour la partie « réconciliation », quand une commission rend des conclusions, elle veille à proposer des mesures de non-répétition des violences et des traumatismes. Elle peut proposer l’inscription de l’histoire des homes aux programmes scolaires, mais aussi la proposition d’un monument commémoratif.
CHEMINEZ : On entend beaucoup parler de l’autonomie de la Corse en ce moment. En 2022, des députés guyanais militaient pour l’autonomie de la Guyane. Qu’est-ce qu’il en est ?
Hélène FERRARINI : Il ne faut pas en parler au passé, ils militent toujours pour plus d’autonomie pour la Guyane. (rires) C’est le cas du président de la collectivité territoriale de Guyane. Les deux députés de Guyane sont aussi sur cette ligne-là. Mais il y a un blocage de la part de l’État. Il y a eu des discussions à Paris, Macron est passé en Guyane en mars 2024. Les députés ont décidé de ne pas le rencontrer, de le boycotter et ont pointé un « simulacre ».

Il y a des tendances autonomistes en Guyane depuis la départementalisation de 1946. Il y a eu plusieurs épisodes, notamment un référendum en janvier 2010 sur la question de l’autonomie. 70,22% du corps électoral a voté contre, et a préféré garder le statut actuel. Mais y a toujours des gens qui veulent plus d’autonomie.
CHEMINEZ : Cette autonomie pourrait avoir un impact sur les homes indiens et sur la vie des autochtones ? C’est une autonomie administrative ?
Hélène FERRARINI : L’idée, c’est qu’une partie des décisions législatives puisse être choisies en Guyane. A l’heure actuelle, la quasi-intégralité des décisions sont prises à l’Assemblée nationale. La Guyane est un département français comme la Creuse, la Mayenne ou le Bas-Rhin.
CHEMINEZ : Qu’est-ce que les Français métropolitains, qui comme toi peuvent être touchées par l’affaire des home indiens, peuvent faire pour participer à ce combat ?
Hélène FERRARINI : Tout d’abord, s’intéresser à l’histoire des homes et des autochtones de Guyane et en se tenant informé. La première étape, c’est une conscientisation, une meilleure connaissance de cette histoire qui nous appartient aussi en tant que Français de l’Hexagone, puisque c’est celle de l’administration par la France de populations guyanaises et du territoire guyanais. Donc on est partie prenante de ces politiques publiques faites au nom de la République, et donc en notre nom.
Ensuite, si on a envie de militer, on peut se rapprocher d’organisations autochtones – il y en a un certain nombre en Guyane – ou d’une organisation comme le CSIA-NITASSINAN, qui est une organisation de soutien aux peuples autochtones basée à Paris. Il y a aussi une pétition en ligne pour l’ouverture d’une commission vérité et réconciliation qui se trouve sur le site de l’Institut Joinet. On peut la signer.
CHEMINEZ : Pour revenir sur la Commission, la procédure prend beaucoup de temps après que la demande a été faite ?
Hélène FERRARINI : À l’heure actuelle, on est dans une sorte de rapport de force entre la société civile et l’État français. Il faut que l’État accepte de participer à une commission de ce type, en la finançant en totalité ou en partie. Pour l’instant, ça bloque, il n’y a pas de participation étatique – d’ailleurs il y a eu des blocages assez importants au niveau de la préfecture de la Guyane ces derniers mois.
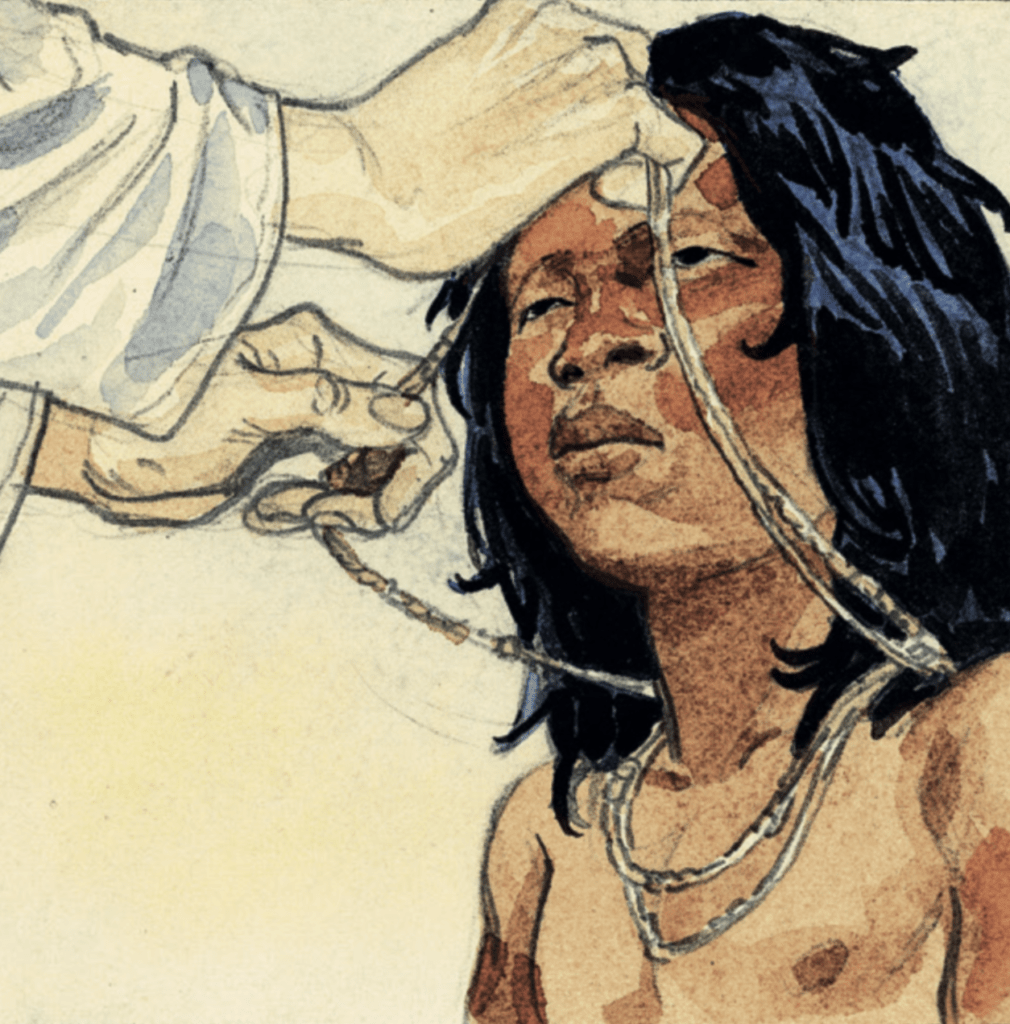
En France, il n’y a pas d’exemples de commissions vérité et réconciliation. Donc tout est à inventer. Parmi les rares précédents français qui peuvent être comparés à une commission vérité et réconciliation pour les homes de Guyane, il y a la commission d’enquête parlementaire sur les enfants réunionnais déplacés de force dans la Creuse. Plus récemment, il y a eu la commission la commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Eglise (CIASE) dirigée par Jean-Marc Sauvé. Mais l’État n’avait pas de part à prendre dans cette dernière commission. L’histoire des homes, c’est une histoire dans laquelle l’État français est engagé : un des acteurs c’est l’église catholique, le deuxième c’est l’État.
Pour que l’État – un ministère, le Parlement ou le Président de la République – se mette en mouvement, il faudrait que la base citoyenne soit suffisamment puissante. Le rapport de force est en train de se faire ; il y a peu, Le Monde a publié une tribune qui demande l’ouverture d’une commission vérité et réconciliation, signée par des personnalités de la société civile assez reconnues dans les champs associatif et scientifique. Les actions se multiplient pour embarquer l’État, qui visiblement n’a pas très envie d’aller sur ce sujet.
CHEMINEZ : De mémoire, les attentes des enfants réunionais de la Creuse avaient été déçus, notamment l’auteur du livre qui avait déclenché le mouvement.
Hélène FERRARINI : Oui, tout à fait. Pour l’instant, ce projet de Commission vérité et réconciliation pour les homes de Guyane, on en parle de manière très théorique. Le plus important, c’est de savoir si les principaux concernés ont vraiment envie de ça. Et si c’est le cas, il faut qu’ils puissent avoir une marge de manœuvre très large sur la forme que cela prendra. Ce moment doit leur appartenir vraiment, et ne doit pas leur être imposé, venir une fois de plus de l’extérieur. Il faut que ce soit une boîte à outils que les gens puissent utiliser s’ils le souhaitent et de la façon dont ils le désirent.
Mais attention, ce que je viens de vous partager, ce sont des vœux très larges ; encore une fois, je ne suis pas partie prenante. Je partage les connaissances historiques que j’ai réussi à accumuler, à croiser, à construire, au fil de mes recherches. Je le répète : je ne suis pas la cheville ouvrière de cette commission vérité et réconciliation ; ce n’est pas ma spécialité, je ne suis pas juriste.

Quand on parle des homes indiens, on a souvent en tête ce qu’il s’est passé au Canada : une institution assez similaire, des pensionnats autochtones, avec des religieux à qui l’État confiait l’éducation des enfants autochtones. Il y a eu une commission vérité et réconciliation en 2015, qui a fait grand bruit. La chronologie canadienne est intéressante : le rapport est publié au Canada 20 ans après la fermeture du dernier pensionnat autochtone dans les années 1990.
En Guyane, c’est un passé vraiment récent, le dernier home indien ayant fermé il n’y a même pas un an à l’heure où on se parle. Parents et enfants étaient encore en train de vivre cette histoire l’année dernière. Pour autant, pour les Kali’na, un peuple autochtone du littoral guyanais, les homes ont fermé il y a plus de quarante ans maintenant. Donc c’est maintenant qu’ils ont besoin d’en parler. C’est une des difficultés à laquelle sont confrontées les personnes qui travaillent pour la réalisation de cette commission vérité et réconciliation : faire tenir ensemble des personnes qui ont des chronologies différentes.
CHEMINEZ : Oui, parfois des enfants essayent de comprendre l’histoire de leurs aïeux, et c’est eux qui sont plus demandeurs que leurs propres parents. Ils ont besoin de connaître leurs racines, leurs origines.
Hélène FERRARINI : C’est assez juste pour la Guyane. Les deuxièmes générations sont en train de jouer un rôle important dans ce réveil mémoriel. On m’a rapporté plusieurs histoires qui le soulignent. Un père de famille, qui a grandi auprès d’un prêtre dans un home, m’a raconté qu’il n’en avait jamais parlé à sa famille, jusqu’au jour où sa fille lit un article de presse sur l’histoire des homes et lui demande de quoi il s’agit. Un sujet tabou est devenu une histoire familiale.

Je pense aussi à un frère et une sœur, qui sont venus à l’Assemblée nationale le 1er février 2024 à l’occasion de la présentation du rapport de l’Institut Joinet. Ils ont pris la parole et ont expliqué qu’ils n’avaient jamais autant parlé avec leur père de ce sujet depuis qu’ils lui avaient annoncé quinze jours plus tôt qu’ils avaient l’intention de se rendre à l’Assemblée nationale pour écouter cette réunion. Là aussi, c’est devenu un sujet familial.
Les familles ont besoin de compréhension, d’éclairage sur certaines thématiques, telles que le rapport à la langue. Pourquoi est-ce que notre père et notre mère ne nous ont pas transmis la langue autochtone ? Parce que c’est une langue qui a été extrêmement dévalorisée lors de leur passage en pensionnat. Ils ont besoin de comprendre pourquoi ils ne parlent pas la langue de leurs parents.
CHEMINEZ : En Guyane, est-ce que les langues autochtones sont en danger ? Comment elles évoluent avec le français et le créole guyanais ?
Hélène FERRARINI : Il y a six peuples autochtones en Guyane : les Kali’na, les Palikur, les Arawak Lokono, les Wayana, les Wayãpi et les Teko. Et ces différentes langues ne sont pas toutes dans la même situation. Certaines sont plus menacées que d’autres ; par exemple, l’arawak-lokono a pratiquement disparu aujourd’hui, et le palikur est assez menacée. L’UNESCO a ses propres catégories. Après, il y a toujours des langues autochtones qui sont parlées, comme le Kali’na, le Wayana, le Wayãpi et le Teko. Mais ce sont des langues de la sphère familiale, ce ne sont pas des langues véhiculaires en Guyane.
CHEMINEZ : Et le créole guyanais ?
Hélène FERRARINI : J’ai l’impression que le créole guyanais et le sranan tongo – un autre créole originaire du Suriname et qui est beaucoup utilisé à l’ouest pour communiquer entre différents groupes – sont des langues qui vivent. Ce ne sont pas des langues de l’administration, ni de l’école, mais ce sont des langues de la rue, de la vie, de l’échange, du commerce, des relations amicales.
CHEMINEZ : On a évoqué tout à l’heure ce que pouvait faire le citoyen métropolitain lambda pour participer à ces combats. Il y a quelques mois, on a interrogé Josiane Ubaud, qui est une lexicographe et ethnobotaniste en domaine occitan, et qui se lamentait du fait que les combats occitans fasse du surplace à cause – dit-elle – d’un certain repli, chacun jouant dans sa propre cour. Est-ce qu’une coordination des associations et groupes autochtones avec les associations et militants pour les langues régionales, ne serait pas la perspective la plus intéressante pour remporter le rapport de force que tu mentionnais ?
Hélène FERRARINI : Peut-être. Je ne sais pas s’il y a eu des rapprochements de ce type. Je sais que, dans leurs combats, les Guyanais se sentent proches des Kanaks de Nouvelle-Calédonie, parce qu’il y a la question coloniale qui est très prégnante dans ces endroits-là.

CHEMINEZ : C’est intéressant que tu mentionnes l’aspect colonial ; Josiane Ubaud rejetait le terme de langue régionale, et veut s’approprier – avec d’autres militants – le terme de langue autochtone ; et elle parle elle aussi de colonisation des régions par Paris.
Hélène FERRARINI : Il me semble que les seuls ressortissants français à avoir pu participer au cycle de négociations de l’ONU sur les droits des peuples autochtones sont les Amérindiens de Guyane. C’est ce qui a donné lieu en 2007 à la Déclaration des Droits Autochtones. Il faudrait chercher les textes de l’époque, ça pourrait être une piste de réflexion intéressante.
CHEMINEZ : En avril 2021, il y avait une loi qui étrangement n’a pas suscité beaucoup de bruit, malgré son importance : la loi Molac, qui a été retoquée par le Conseil Constitutionnel à la demande de la Macronie. La loi permettait une reconnaissance administrative des langues régionales et autochtones ; une place à l’enseignement immersif ; et la reconnaissance des signes diacritiques régionaux à l’état civil. Plusieurs points que tu as mentionnés au sein de notre entretien et dans ton livre entraient dans le domaine d’application de la loi Molac.
Hélène FERRARINI : Quand ils ont présenté le rapport à l’Assemblée nationale – ce n’était pas dans l’hémicycle mais dans une salle de réunion –, ce sont surtout des députés ultramarins qui sont venus. Il y a peut-être un cloisonnement entre les sujets ultramarins et de l’autre les sujets hexagonaux, alors qu’il y aurait des ponts tout à fait pertinents à construire.






Votre commentaire