Le 13 avril 2023, les librairies japonaises ont exceptionnellement ouvert leurs portes à minuit, pour le plus grand bonheur des centaines de personnes qui attendaient patiemment devant. Rien d’étonnant à cela ! Quelques semaines plus tôt, la maison d’édition Shinchosha avait annoncé la parution à cette date du quinzième roman de Haruki Murakami, l’écrivain japonais le plus lu au monde.
Pour se rendre compte de l’ampleur du phénomène, quelques données essentielles. Haruki Murakami, c’est donc quinze romans, cinq recueils de nouvelles et plusieurs essais, édités en une cinquantaine de langues. Depuis 1987, chacun de ses romans s’est vendu en moyenne à 2 millions d’exemplaires au Japon, et l’écrivain a remporté de nombreux prix et récompenses prestigieux, dont le Prix Gunzō du premier roman pour Écoute le chant du vent (1979), le Prix World Fantasy pour Kafka sur le rivage (2002) ou encore le Prix Franz Kafka. Depuis 2006, il est le favori des bookmakers pour le Prix Nobel de Littérature.

Conscient que le simple nom de Murakami suffit à écouler des centaines de milliers d’exemplaires – d’autant plus lorsqu’il s’agit de son premier roman depuis Le Meurtre du Commandeur (2017) – l’éditeur a choisi de diffuser très peu d’informations sur ce nouveau livre de l’auteur de Kafka sur le rivage (2002).
En réalité, seules deux informations avaient été dévoilées à la presse : un titre énigmatique, La Cité aux murs incertains (Machi to sono futashika na kabe), et une accroche tout aussi mystérieuse : « Une histoire enfermée commence à avancer tranquillement, comme si de vieux rêves étaient réveillés et dénoués dans une archive isolée. » La parution, le 2 janvier 2025, du roman aux éditions Belfond nous a enfin permis de découvrir ce vieux rêve qui est sorti de son sommeil.
Le narrateur de ce roman est un lycéen de 17 ans qui rencontre une camarade, d’un an sa cadette, dont il tombe éperdument amoureux. Par chance, cet amour est réciproque. Un jour, la jeune fille lui confie qu’elle n’est qu’une ombre et que son « vrai moi » se trouve dans une cité entourée de grandes murailles, où les habitants vivent sans ombre et où paissent des licornes. Elle lui parle aussi d’une bibliothèque où l’on lit de vieux rêves. Puis, un jour, la jeune fille disparaît. Des décennies plus tard, le narrateur pénètre dans cette cité pour retrouver son amour d’adolescence.

Bien qu’il ait été très apprécié par la presse japonaise et internationale, le nouveau roman de Haruki Murakami a suscité néanmoins quelques critiques, notamment de la part de The New York Times qui regrette que l’écrivain japonais raconte une histoire qu’il a déjà contée par le passé.
En effet, à la lecture de notre résumé de La Cité aux murs incertains, les lecteurs assidus de Murakami auront sans doute en tête son quatrième roman, La Fin des Temps, publié au Japon en 1985. Déjà à l’époque, l’histoire évoquait un jeune homme qui débarque dans une cité mystérieuse, entourée de murailles et peuplée de licornes, où la condition pour y résider est d’abandonner son ombre. Pourtant, il nous parait important de replacer La Cité aux murs incertains dans l’œuvre de son auteur pour comprendre à quel point il ne s’agit pas d’une répétition, mais plutôt de l’aboutissement d’une démarche artistique.
Dans la postface, Haruki Murakami révèle que l’idée de cette cité le hante depuis l’écriture d’une nouvelle parue en 1980, La Cité et ses murs incertains, qu’il n’avait pas jugée satisfaisante à l’époque. L’écriture de La Fin des Temps avait été une première tentative pour l’écrivain japonais de « transformer cette nouvelle en roman véritable ». Au fil des ans, Haruki Murakami a de plus en plus le sentiment que sa cité « n’avait pas trouvé l’accomplissement qu’elle méritait ». C’est ainsi que, profitant de la pandémie de Covid-19, il retravaille entièrement cette histoire, quarante ans après.
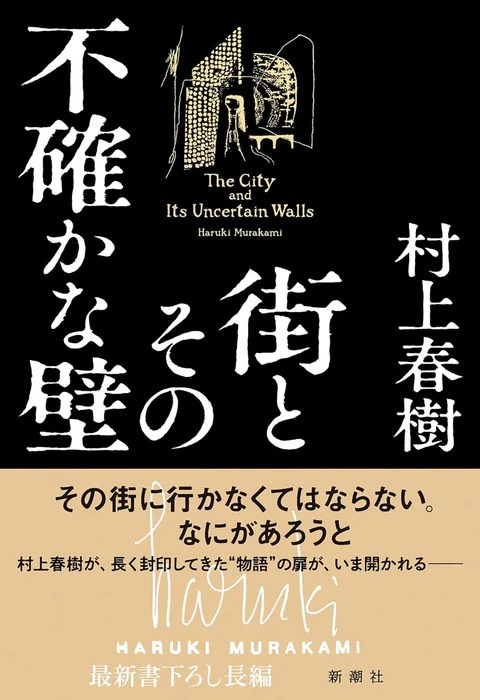
En plus de nous renseigner sur le projet de l’écrivain, cette postface permet également de désamorcer une critique : non, La Cité aux murs incertains n’est pas une redite de La Fin des Temps ; bien que les deux romans évoquent une cité similaire régie par les mêmes principes, ils ne racontent pas la même histoire et ne lui donnent pas la même fonction. Pour le dire autrement, la cité semble suivre le même chemin que les sous-titres du diptyque Le Meurtre du Commandeur : « une idée apparaît », puis « la métaphore se déplace ».
Dans La Fin des Temps, Haruki Murakami développe deux histoires alternativement et en parallèle, jusqu’à les fusionner à la fin du roman. Un modèle de narration que l’écrivain réutilisera par la suite dans Kafka sur le rivage et dans la trilogie 1Q84 (2009-2010). Dans les chapitres impairs, l’écrivain japonais raconte l’histoire d’un « programmeur » de 35 ans, divorcé et sans enfants, chargé d’encrypter les données du projet d’un vieux professeur ; dans les chapitres pairs, un homme débarque dans une cité fortifiée où les sentiments n’existent plus, et dont il deviendra le « liseur de rêves » après s’être débarrassé de son ombre et s’être fait marquer les yeux. À la fin du roman, le lecteur comprend que la Cité est une simulation se déroulant à l’intérieur du cerveau du « programmeur », dont il finira par être entièrement prisonnier.
En exploitant à la fois les tropes du mouvement cyberpunk et de la fantasy, Haruki Murakami s’attachait à étudier et à décrire le mal-être d’une société japonaise en pleine mutation, et dont les grandes avancées économiques et technologiques étaient permises grâce à l’exploitation de salarymen aliénés. Non content de quitter une prison pour une autre plus petite, le protagoniste le fait à son insu. Les lecteurs se souviennent sans doute de cette scène déchirante où le « programmeur » attend tragiquement dans sa voiture que sa conscience s’efface en écoutant A Hard Rain’s A-Gonna Fall de Bob Dylan, avant d’exister uniquement dans la simulation de cité.
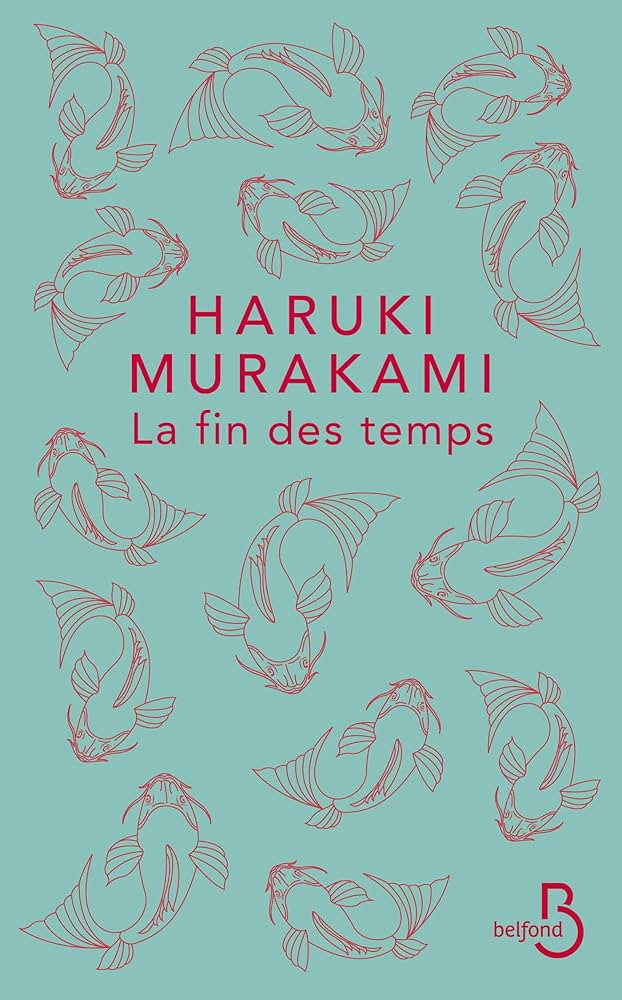
Le livre La Cité aux murs incertains est organisé selon une structure complètement différente. La première partie de l’ouvrage nous propose alternativement la brève mais intense histoire d’amour entre le narrateur lycéen et sa camarade de bahut, et le séjour du narrateur dans la Cité entourée de murailles. Dans la seconde partie, le narrateur, au milieu de la quarantaine, a quitté la cité pour retrouver le monde réel et devient le directeur d’une petite bibliothèque de campagne. Dans la troisième et dernière partie, le narrateur est de nouveau dans la Cité afin de permet à un jeune garçon autiste d’y entrer.
Contrairement à La Fin des Temps, les personnages de La Cité aux murs incertains choisissent de se rendre dans cette ville mystérieuse, qui est réservée à celles et ceux qui ne trouvent pas leur place dans le monde contemporain. Bien qu’il soit quasiment impossible d’en sortir, le narrateur parvient à faire des va-et-vient entre ces deux mondes.
Le motif du « deuxième monde caché » est récurrent, pour ne pas dire quasi-omniprésent, dans l’œuvre de Haruki Murakami. Ces mondes peuvent être oniriques, comme dans Chroniques de l’oiseau à ressort (1994-1995), ou encore physiques et nécessitent un point de passage pour y entrer, comme dans 1Q84, Kafka sur le rivage et Le Meurtre du Commandeur. Les protagonistes des romans de Haruki Murakami y entrent généralement contre leur volonté, mais y résolvent leurs problèmes. Les amoureux de jeunesse Tengo et Aomamé se retrouvent dans le monde de l’année 1Q84, Toru Okada parvient à retrouver sa femme évaporée dans l’étrange chambre 208 dans Chroniques de l’oiseau à ressort et Kafka Tamura rencontre une version plus jeune de Mlle Saeki dans Kafka sur le rivage.
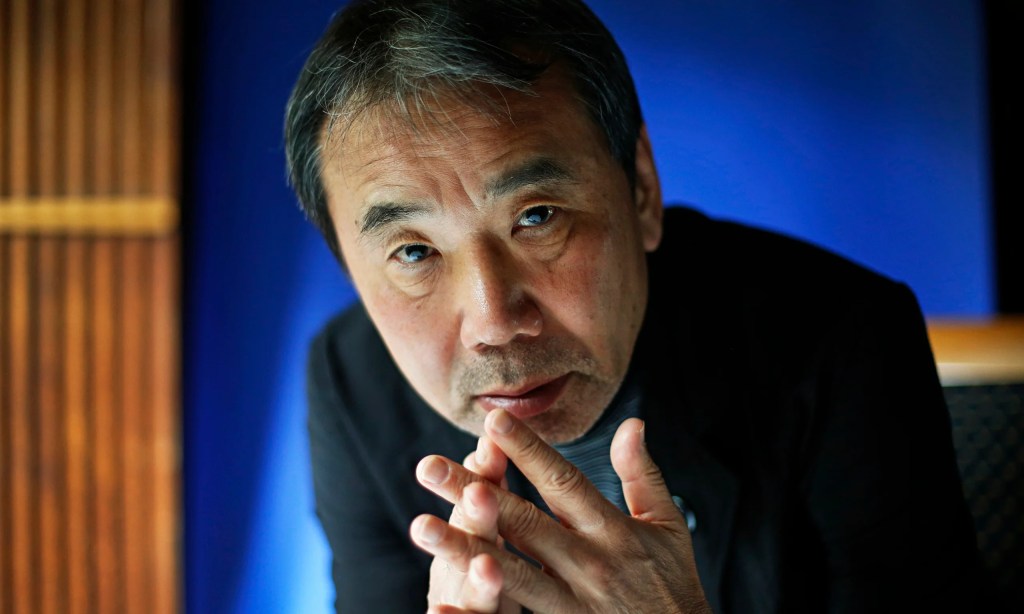
Pour autant, la ville de La Fin des Temps et La Cité aux murs incertains n’est pas un lieu où le protagoniste défait les nœuds de son existence, mais plutôt un monde de substitution. Elle n’a rien d’idyllique. Les hivers y sont tellement rudes que les licornes meurent en masse, et n’y est toléré uniquement ce qui est nécessaire. C’est la raison pour laquelle ni les arts, ni les sentiments, ni même les souvenirs et les ombres n’ont leur place dans cette cité. En son centre se trouve une tour avec une horloge sans aiguille.
La Cité au murs incertains nous raconte le destin de personnages qui n’arrivent pas à s’ancrer dans le monde, pour divers motifs. À ce titre, le narrateur est l’archétype du héros murakamien. Il est solitaire, aime lire, écoute du jazz et de la musique classique, et trouve du réconfort dans la répétition du quotidien. Il est surtout un homme ordinaire, qui est « embarqué dans la vie quotidienne de manière irrévocable et essaie de [s’] accrocher à la surface de la Terre. » Sa grande sensibilité s’exprime à travers de nombreuses comparaisons et métaphores, qui sont les deux figures de style privilégiées des personnages de Murakami. Ainsi, pour lui, le soupir d’un vieil homme veuf est « aussi profond qu’un puits ancien ».
Bien évidemment, le nouveau roman de Haruki Murakami trouve une résonance particulière à notre époque, à l’ère des hikikomori – principalement des jeunes hommes qui, accablés par la société et par le sentiment de ne pas parvenir à accomplir leurs objectifs de vie, décident de se couper complètement du monde et des autres en restant cloîtrés (on pourrait presque dire emmurés) dans leur chambre. Depuis 2010, leur nombre au Japon est passé de 230 000 à un million, selon les statistiques les plus récentes.
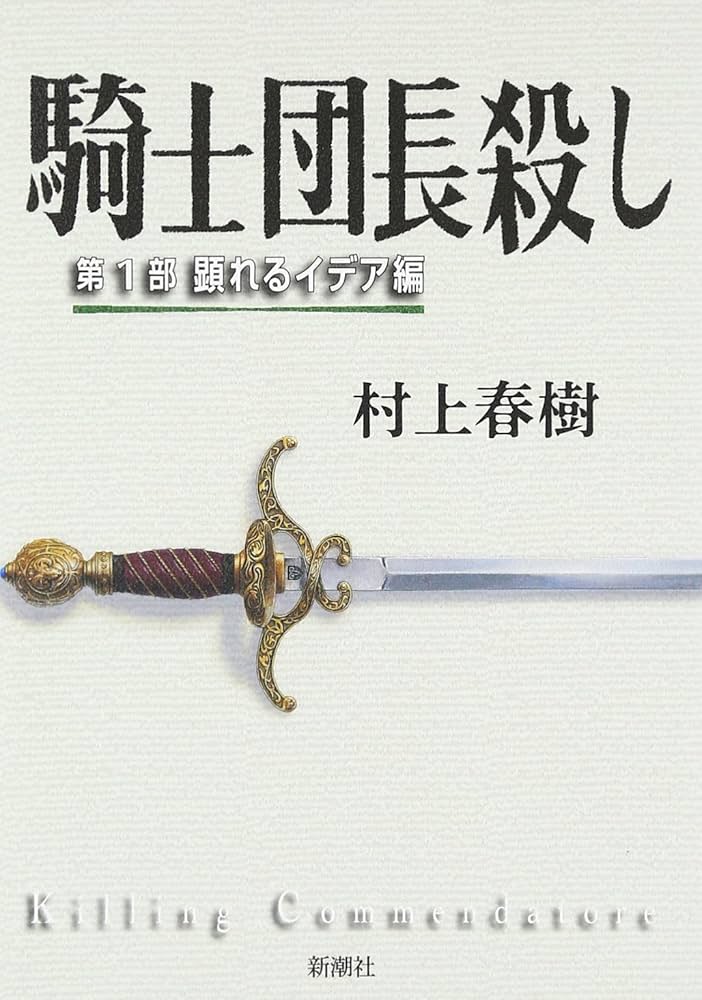
En grand observateur du Japon depuis plus de quarante ans, Haruki Murakami a vu la société japonaise évoluer au fil du temps. Et de la même manière qu’un corps changeant de forme verra son ombre modifiée, le mal-être des Japonais a suivi les mutations sociales à l’œuvre dans le pays. Ainsi, il en va de la tristesse de Watanabe dans La Ballade de l’impossible, dont les préoccupations existentielles ne parvenaient pas à l’incarner pleinement dans la contre-culture japonaise de la fin des années 1960, et de celle de Toru Okada (Chroniques de l’oiseau à ressort), qui est inextricablement liée à l’explosion de la bulle économique japonaise au début des années 1990. De la même manière, les protagonistes de La Fin des Temps et de La Cité aux murs incertains, appartenant à des époques différentes, éprouvent eux aussi un mal-être différent.
Il y a d’ailleurs un grand paradoxe dans la réception des romans de Haruki Murakami au Japon et en Occident qu’il nous parait important de relever ; bien qu’il soit l’écrivain japonais le plus lu, l’auteur de La Course au mouton sauvage (1982) a souvent été critiqué car considéré comme pas assez japonais. (Un paradoxe que l’on retrouve d’ailleurs à l’égard du réalisateur Hayao Miyazaki.) Le fait que les premiers chapitres de son premier roman – Écoute le chant du vent – ont d’abord été écrits en anglais avant d’être traduits en japonais afin de travailler une langue originale, et que l’auteur cite abondamment des romans américains et des disques de jazz et de musique classique européenne, a sans aucun doute contribué à lui donner cette réputation d’écrivain japonais « occidental ».
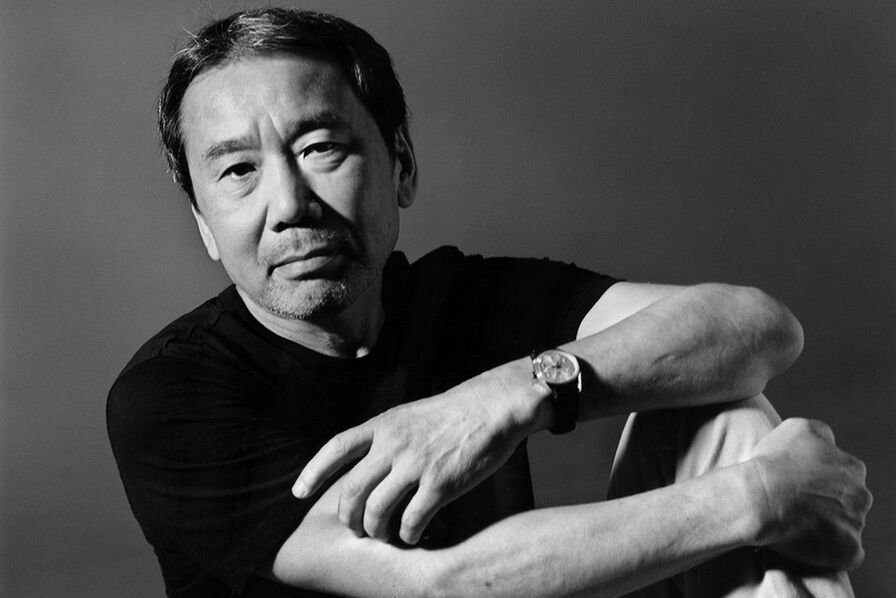
Bien évidemment, on pourrait rétorquer que le Japon a une longue tradition de traduction de littérature étrangère, remontant à l’ère Meiji (fin du XIXème siècle), et que le pays est l’un des plus grands consommateurs de musique au monde, notamment de jazz, de blues et de musique classique européenne, au point d’influencer des musiciens comme Yoshiko Kishino, Hiromi Uehara, Seiji Ozawa et Joe Hisaishi. Mais il faut également souligner que, à l’instar du co-fondateur du studio Ghibli, la culture japonaise prend de plus en plus de place dans l’œuvre littéraire de Haruki Murakami.
Dans ses premiers romans, l’auteur citait rarement des écrivains japonais : dans La Course au mouton sauvage, le narrateur découvre le suicide par seppuku de Yukio Mishima à la télévision, tandis que Watanabe confie ne pas s’intéresser à la littérature japonaise au début de La Ballade de l’impossible :
« Les auteurs que j’aimais alors s’appelaient Truman Capote, John Updike, Scott Fitzgerald, ou Raymond Chandler, mais, en classe comme au foyer, je ne trouvais personne aimant lire ce genre de romans. Ils lisaient tous Kazumi Takahashi, Kenzaburō Oe, Yukio Mishima, ou encore des écrivains français contemporains. Il était donc normal que nous n’ayons pas de sujets de conversation communs, et je pris l’habitude de lire mes livres seul en silence. Je lisais et relisais mes livres, et, fermant les yeux de temps en temps, j’aspirais profondément leur odeur.«
À ce titre, la parution de Kafka sur le rivage en 2002 marque une première mutation. Non seulement le jeune Kafka Tamura lit de la littérature japonaise – il a notamment apprécié la lecture du roman Le Mineur de Natsume Sôseki –, mais en plus l’intrigue du roman mêle la structure du mythe d’Œdipe à des éléments narratifs issus du conte Le rendez-vous des chrysanthèmes, compris dans les Contes de pluie et de lune de Ueda Akinari (1776). Dans la trilogie 1Q84, la jeune et mystérieuse Fukaéri est capable de citer des passages du roman médiéval Le Dit des Heiké, tandis que la clochette bouddhique qui sonne toute seule dans Le Meurtre du Commandeur évoque à Minshiki un autre conte de Ueda Akinari, présent dans Les Contes de pluie de printemps.

Dans La Cité aux murs incertains, le jeune Yellow Submarine connait par cœur de nombreux classiques de la littérature japonaise. Par ailleurs, Murakami prend beaucoup plus de temps qu’à l’accoutumée à décrire certains rites de commémoration shintoïstes ainsi que des codes de politesse japonais. Ainsi, à certains égards, Haruki Murakami semble opérer une transformation, certes moins radicale, mais comparable à celle de Tomohiko Amada, le peintre japonais du Meurtre du Commandeur qui a subitement arrêté de faire de la peinture à l’occidentale pour se spécialiser dans la peinture nihonga – traditionnelle japonaise – après la fin de la Seconde Guerre Mondiale.
Comment expliquer cette « japonisation » de l’œuvre de Haruki Murakami ? S’il est effectivement courant que l’âge avançant, certains artistes renouent avec leur culture, cette transformation chez Murakami peut également être due à une évolution qu’il entretient avec un mouvement littéraire : « le réalisme magique ».
Cette expression, créée par le critique d’art allemand Franz Roh pour désigner le surgissement d’éléments magiques et surnaturels dans des oeuvres picturales considérées comme réalistes, est devenue un mouvement littéraire après que des écrivains sud-américains tels que l’argentin Jorge Luis Borges ont importé le concept en Amérique du Sud. Mais le réalisme magique ne se contente pas de superposer le surnaturel et le réel et entretient des relations particulières avec l’Histoire. Plutôt que de relater de simples événements, il permet d’explorer un passé commun de manière créative et de remettre en cause les discours dominants. C’est le cas notamment de Cent ans de solitude de Gabriel Garcia Márquez (1967).

Dès son troisième roman, La Course au mouton sauvage, l’auteur racontait les aventures d’un jeune tokyoïte désabusé, mandaté par un homme étrange au service d’une organisation secrète d’extrême-droite pour retrouver un mouton étoilé capable de manipuler l’Histoire. Le réalisme magique permettait à Haruki Murakami de condamner la manière dont l’extrême-droite japonaise manipule le passé récent de l’Archipel, notamment concernant l’annexion de la Corée, la Mandchourie ou encore les kamikazes.
Après La Fin des Temps (qui mélangeait cyberpunk et fantasy), La Ballade de l’impossible (son roman le plus réaliste) et Au Sud de la Frontière, à l’ouest du soleil (un court récit aux accents fantastiques), Haruki Murakami a réinvesti le réalisme magique avec Chroniques de l’oiseau à ressort. Pour son plus gros roman à l’époque – on parle quand même d’un pavé de 1000 pages, divisé en trois volumes au Japon et édité en un seul en France –, Haruki Murakami repousse plus que jamais les limites floues entre le réel et l’irréel. Souvent considéré comme son meilleur roman, Chroniques de l’oiseau à ressort confronte également le lectorat japonais au passé violent du Mandchoukuo chinois à travers le personnage du vieux soldat à la retraite obsédé par les puits.
Chez Haruki Murakami, les personnages du présent sont souvent confrontés à des énigmes, dont ils doivent trouver la solution dans le passé. Pour comprendre la signification d’un tableau de nihonga qui le hante et dont la découverte a provoqué divers événements surnaturels, le narrateur du Meurtre du Commandeur découvre l’histoire tragique du peintre Tomohiko Amada et de son frère, qui a été forcé par sa hiérarchie à participer à des massacres en 1937 et s’est ensuite donné la mort. Dans Kafka sur le rivage, le vieux Nakata ne sait plus ni lire ni écrire, parle de lui à la troisième personne et a la capacité de converser avec les chats depuis un événements paranormal qui s’est déroulé durant la Seconde Guerre Mondiale.

Rétif à toutes les étiquettes, Haruki Murakami a longtemps rejeté l’idée que son œuvre littéraire appartienne au réalisme magique. D’ailleurs, il tourne en dérision le mouvement en 1989 avec la nouvelle TV People (parue en France dans L’éléphant s’évapore), écrite sur le modèle de l’écrivain sud-américain Jorge Luis Borges (Le Jardin des sentiers qui bifurquent). Mais contrairement à Borges, le récit de Murakami est un labyrinthe avec une entrée mais pas de porte de sortie. Il cite également « ce nouveau roman de Gárcia Márquez », l’autre grande figure du réalisme magique. Le protagoniste peine à se concentrer et à lire plus d’une page et demie de ce « long roman ».
Du temps a passé depuis, Haruki Murakami a écrit lui aussi de longs romans labyrinthiques, comme Chroniques de l’oiseau à ressort et 1Q84, et l’écrivain semble enfin consentir au fait que ses œuvres appartiennent au réalisme magique. Dans la deuxième partie de La Cité aux murs incertains, le narrateur discute avec la tenancière d’un café de littérature et cette dernière lui lit un passage de L’Amour au temps du choléra de Gabriel Garcia Márquez. Haruki Murakami inclut toute une citation de l’écrivain colombien.
À bien y réfléchir, la rédaction de Kafka sur le rivage et du Meurtre du Commandeur a sans doute joué un rôle dans l’acceptation par Haruki Murakami du réalisme magique. En effet, en réutilisant des éléments des contes de Ueda Akinari, mais également du Dit du Genji de Murasaki Shikibu, l’auteur place « son » réalisme magique dans la tradition littéraire classique japonaise, où le réalisme laissait une place aux fantômes et aux événements surnaturels.

La Cité aux murs incertains est donc le résultat de nombreuses évolutions dans l’œuvre murakamienne, à la fois sur le fond et sur la forme. Il sera bien évidemment possible de faire de nombreux ponts avec les précédents romans de l’écrivain japonais, notamment dans la répétition de certains leitmotivs. Par exemple, la bibliothèque et les fantômes évoqueront Kafka sur le rivage, l’isolement du narrateur au début de l’âge adulte rappellera celui infligé au protagoniste de L’Incolore Tsukuru Tazaki et ses années de pèlerinage.
À ce titre, le roman est une très belle porte d’entrée à l’univers de Haruki Murakami et à sa poésie. Parce que oui, on n’a peut-être pas suffisamment insisté là-dessus, mais La Cité aux murs incertains est un très beau roman, plein de poésie et de mélancolie. La simplicité du style de Murakami laisse beaucoup de place aux métaphores et aux comparaisons, et l’auteur excelle pour décrire la beauté des paysages et la complexité des sentiments.
« Tu t’étais assise dans l’herbe d’été, sans doute fatiguée d’avoir tant marché, puis tu as regardé le ciel sans rien dire. Deux petits oiseaux, l’un à côté de l’autre, avaient traversé l’espace en poussant des cris aigus. Dans le silence revenu, un présage de crépuscule bleuté a commencé à nous envelopper, toi et moi. Quand je me suis assis à tes côtés, j’ai éprouvé une curieuse sensation. C’était comme si des milliers de fils invisibles reliaient délicatement ton corps à mon cœur. Même le plus ténu clignement de tes paupières ou l’esquisse d’un tremblement de tes lèvres bousculaient mon cœur. »
Vous l’aurez compris, nous vous encourageons vivement à découvrir La Cité aux murs incertains. Si cet article vous a intéressé et si comme nous vous appréciez le réalisme magique, nous vous encourageons à découvrir également Le Rêve du Jaguar de Miguel Bonnefoy (Grand Prix de l’Académie française, Prix Fémina) et à lire l’interview qu’il nous a accordée.






Votre commentaire